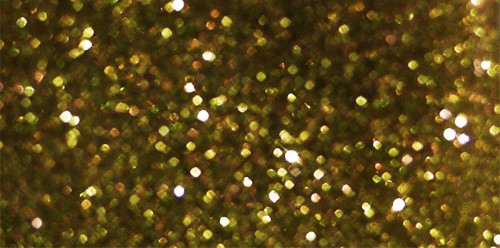BARTHES: MYTHES
ET SIGNES
À l’aide de modèles dérivés de l’œuvre du linguiste suisse Ferdinand de Saussure. Dans son Cours de linguistique générale, Saussure met l’accent sur la nature arbitraire du signe linguistique. Pour Saussure, le langage est un système de valeurs en relation réciproque au sein duquel des « signifiants » arbitraires (des mots) sont liés à des « signifiés » non moins arbitraires (des « concepts […] définis négativement par leurs rapports avec les autres termes du système ») pour former des signes. Pris ensemble, ces signes constituent un système. Chaque élément est défini par la position qu’il occupe dans le système – par sa relation avec les autres éléments – par le biais de la dialectique de l’identité et de la différence. Saussure faisait l’hypothèse que d’autres systèmes de sens (comme la mode, la cuisine, etc.) pouvaient être étudiés de façon similaire et qu’en dernière analyse la linguistique en viendrait à faire partie d’une science plus générale des signes – d’une sémiologie. Barthes s’employait à mettre à jour le caractère arbitraire des phénomènes culturels et à dévoiler la signification latente d’une vie quotidienne qui revêtait toutes les apparences de la naturalité. Contrairement à Hoggart, Barthes ne cherchait pas à distinguer la bonne culture de masse de la mauvaise, mais plutôt à montrer que toutes les formes et tous les rituels censément spontanés des sociétés bourgeoises contemporaines étaient l’objet d’une distorsion systématique, susceptibles d’être à tout moment déshistoricisés, « naturalisés », transformés en mythes : « La France tout entière baigne dans cette idéologie anonyme : notre presse, notre cinéma, notre théâtre, notre littérature de grand usage, nos cérémoniaux, notre Justice, notre diplomatie, nos conversations, le temps qu’il fait, le crime que l’on juge, le mariage auquel on s’émeut, la cuisine que l’on rêve, le vêtement que l’on porte, tout, dans notre vie quotidienne, est tributaire de la représentation que la bourgeoisie se fait et nous fait des rapports de l’homme et du monde. » (Barthes, 1957.)
Tout comme chez Eliot, chez Barthes la notion de culture s’étend bien au-delà de la bibliothèque de l’opéra et du théâtre pour embrasser la totalité de la vie quotidienne. Mais Barthes attribue à c ette vie quotidienne une signification tout à la fois plus insidieuse et plus systématique. Partant de la prémisse selon laquelle « le mythe est une parole », l’auteur des Mythologies s’emploie à dévoiler et à explorer le système normalement occulte de règles, de codes et de conventions à travers lesquels les significations propres à un groupe social spécifique (celui des détenteurs du pouvoir) sont transformées en données universelles pour l’ensemble de la société. Dans des phénomènes aussi hétéroclites qu’un match de catch, les vacances d’un écrivain ou un guide touristique, il décèle la même nature artificielle, le même noyau idéologique. Chacun d’entre eux se voit en effet soumis à la même rhétorique (celle du sens commun) et transformé en mythe, en simple élément d’un « système sémiologique second » (Barthes, 1957). (Barthes prend l’exemple d’une photographie de Paris Match montrant un soldat noir qui exécute un salut au drapeau tricolore, image dans laquelle il déchiffre une double connotation : (1) au premier degré, un geste de loyauté, mais aussi, (2) au second degré, l’idée « que la France est un grand empire, que tous ses fils, sans distinction de couleur, servent fidèlement sous son drapeau ».) En appliquant une méthode d’origine linguistique à des formes de discours non langagiers comme la mode, le cinéma, la cuisine, etc., Barthes a ouvert des horizons insoupçonnés aux cultural studies contemporaines. Grâce à ce type d’analyse sémiotique, il semblait désormais possible de repérer et de mettre à jour le fil invisible qui court entre le langage, l’expérience et la réalité et, simultanément, de combler magiquement le fossé entre l’intellectuel aliéné et le monde « réel » en dotant ce dernier d’un sens nouveau. En outre, avec l’aide de Barthes, la sémiotique semblait offrir la possibilité séduisante de réconcilier les deux définitions contradictoires du concept de culture et de résoudre l’ambiguïté constitutive des cultural studies. Elle promettait l’alliance de la conviction éthique (en l’occurrence, les convictions marxistes de Barthes) et des thématiques à la mode : l’analyse de l’intégralité du mode de vie d’une société.