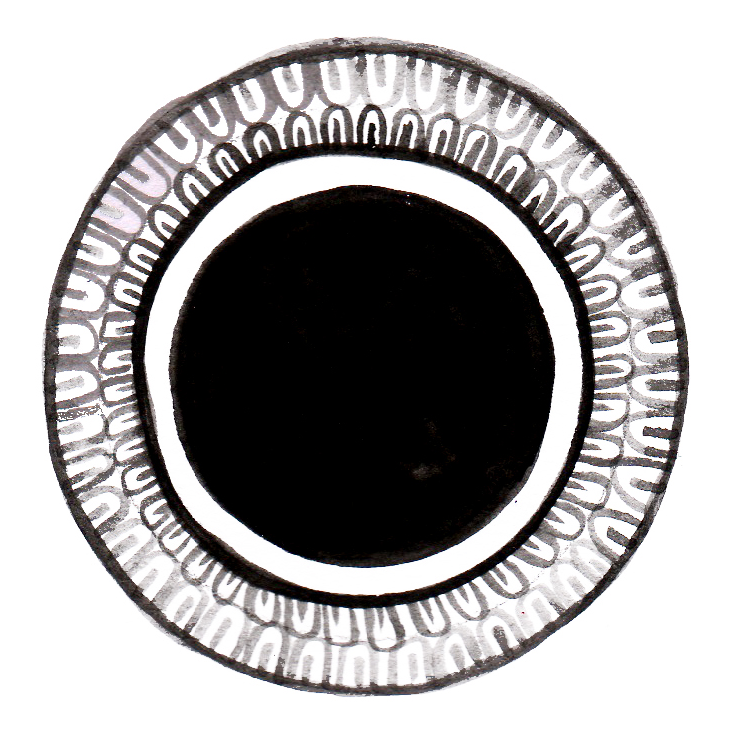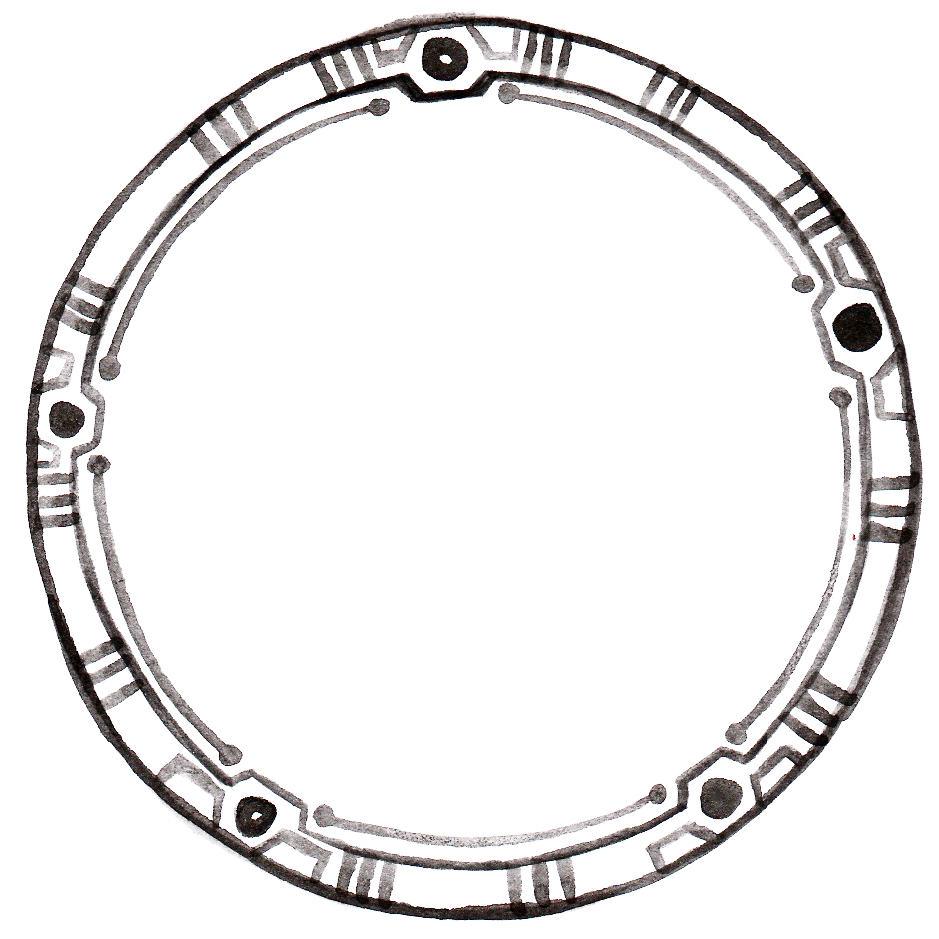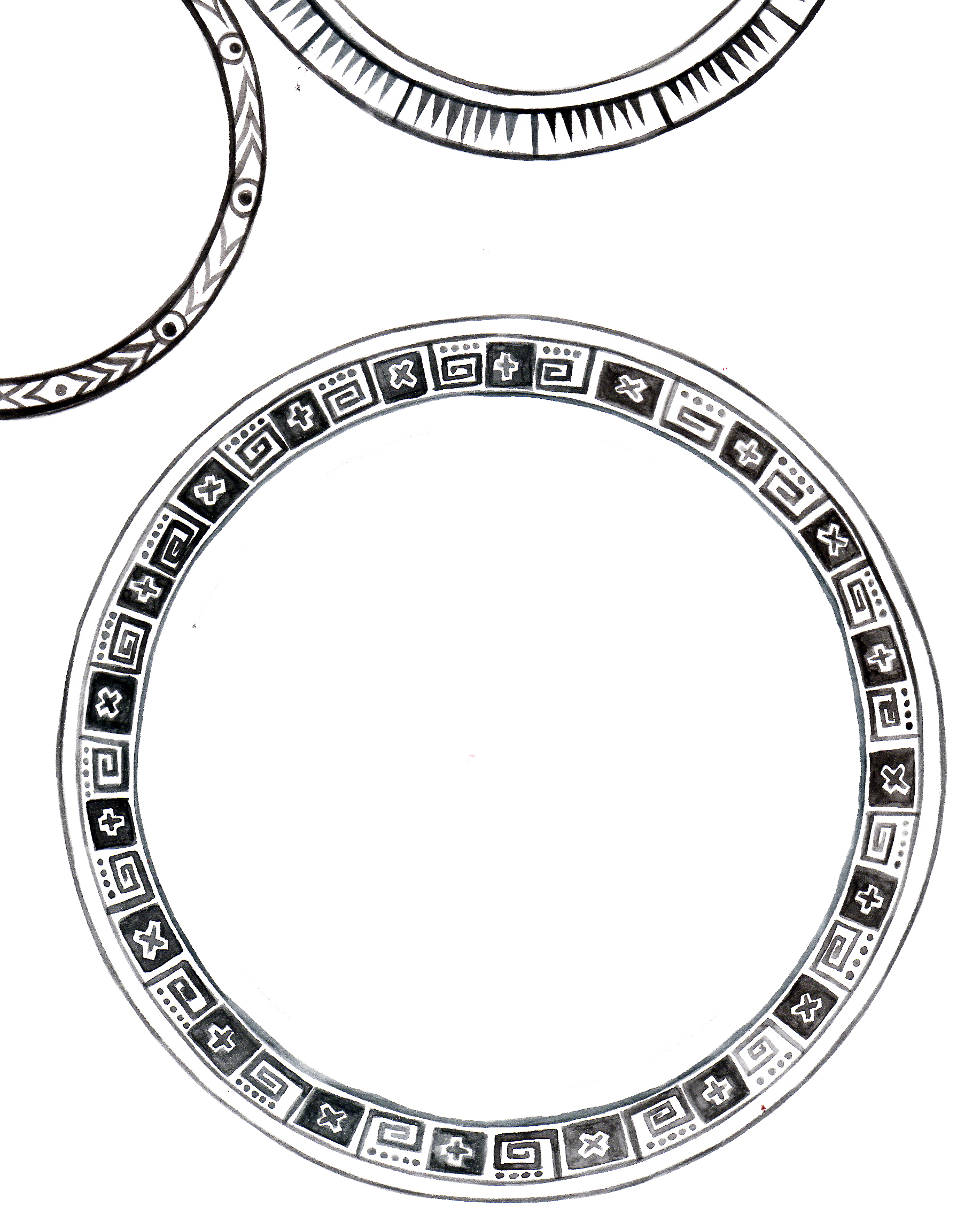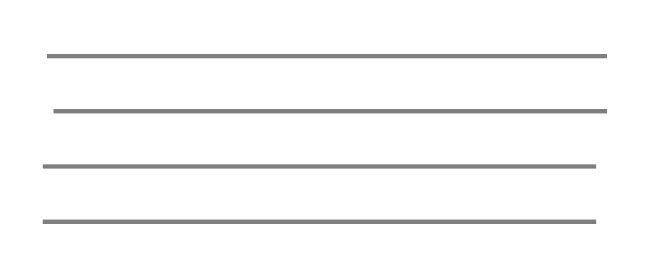-Je suis surpris par la tournure qu’ont pris les évènements. Vraiment je...
Une lumière les éclaira brusquement.
- Salut Pierrot. Désolé, je débarque.
- Bonjour Jean. Eh bien, tu as tout raté. Visiblement, l’histoire touche à son terme.
- Ah, zut ! Et pourtant, je me suis dépêché de manger ! Je te jure, j’ai même pas fini mon sandwich !
- Oui, eh bien... Mais, tu manges des sandwiches, toi, maintenant ?
- Bah ! J’avais faim ! Oh, attends, j’ai du saucisson coincé entre les dents... Oups ! Pardon, regardez ailleurs. Heureusement, j’ai les ongles longs.
- Mais pourquoi fais-tu... On n’a pas besoin de... Ah ! Mais tu t’essuies sur ta tunique. C’est de pire en pire avec l’âge. Arrête ! Non, ne me touche pas !
Il y eut quelques bruits de lutte avant un grognement final qui annonçait la victoire de l’un des deux.
- Voilà ! Bon, donc, je disais : tu as tout raté.
- Ouais, ouais...
Le nouvel arrivant s’installa à la gauche du premier. Il posa lourdement un livre volumineux sur la table qui les séparait de l’autre. Il l’ouvrit à un signet et se saisit d’une plume, tout en faisant des bruits de succion avec la bouche.
- Mais vous pouvez pas tout recommencer ? demanda-t-il.
Il s’adressait au troisième personnage. Une pause.
- C’est à moi que vous parlez ?
- Bah oui, pas au pape ! répondit la nouvelle voix, à droite.
Il gloussa.
- Cher monsieur. Mon histoire a duré au moins trois heures, répondit l’autre.
- Bah ! C’est pas si long ! Et puis, on parle de vous, là.
- Pardon ?
- Ça devrait vous faire plaisir.
- Mais, monsieur ! Vous plaisantez ? Comprenez que ce que j’ai à dire n’est pas très agréable.
- Oh, mais ne vous inquiétez pas pour moi, j’ai hâte de vous entendre !
- Excusez-moi ?
- Eh bien, oui, pourquoi croyez-vous que je me sois dépêché ainsi ? Je suis tout le temps en retard, d’accord, mais là, j’ai fait un effort. Enfin, normalement, je suis vraiment en retard. C’est que ce n’est pas tous les jours qu’on peut rencontrer quelqu’un de votre trempe ! Une vie si bien remplie ! Ouais, ça, ça sera pour des siècles et des siècles ! Je m’en serais voulu de vous avoir raté. Non, non, allez ! Je vous écoute. En selle !
- Mais monsieur, cela suffit ! Je vous écoute, rien du tout ! J’ai l’impression de cuire une pierre !, s’exclama-t-il avec force, vous voulez, vous voulez ! Combien de fois vais-je devoir me répéter ? Je suis épuisé ! Qu’on me laisse ! Me reposer !
- Mais enfin, ne vous énervez pas...
- Et puis, comment me connaissez-vous ? Ma vie, ce que j’ai fait ? Si vous savez déjà tout, pourquoi me tourmentez-vous ? Et puis d’où provient cette lumière aveuglante ? Où sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Comment suis-je arrivé jusqu’ici ?
Il regardait partout autour de lui.
- Est-ce un interrogatoire ? Est-ce mon supplice ? Les Ombres sont-elles en fait lumineuses ? Si je refuse, allez-vous sortir les pinces et les épines ?
- Calmez-vous, dit la voix de gauche, il ne s’agit pas du tout de cela. Nous sommes ici pour tout consigner une bonne fois pour toutes. Pour faire le bilan.
- Le bilan ! Le bilan ! Mais quel bilan ? De quoi ?
- De votre vie, continua posément la voix, écoutez, ça n’arrive pas tous les jours.
- Une fois par existence pour être exact, renchérit la voix de droite.
- Vous devriez en profiter, ajouta celle de gauche.
- De toute façon, vous êtes bloqué ici tant que vous aurez pas tout déballé, dit l’autre d’un ton léger.
- Jean ! dit l’autre, énervé, un peu de tenue à la fin !
- Bah quoi, c’est vrai ! Moi je vous demandais la permission par politesse, mais en fait, vous n’avez pas le choix, dit-il au troisième homme, goguenard.
- Tais-toi ! Bon, écoutez, soyez compréhensif. C’est notre travail. Et Jean dit la vérité ; il devait tout écouter lui aussi ; de toute façon, il doit tenir le registre et va devoir faire un compte-rendu. C’est la loi. Il n’était pas censé arriver en retard, dit-il, semblant s’incliner vers l’origine de la voix de droite avec insistance. Alors autant rendre ce moment agréable pour tout le monde. Donc, continua-t-il, d’un ton plus autoritaire, reprenez tout depuis le début. Ce sera d’autant plus clair pour les nouveaux arrivants.
- On va en avoir plein les mirettes ! Enfin les esgourdes ! Top départ ! Go !, dit la voix de droite avec enthousiasme.
- Jean, je te préviens, je...
- C’est bon, c’est bon, je me tais, je me tais.
Jean reprit sa plume qu’il tint prête à l’emploi. L’autre s’était calmé. Il gardait le silence. Il regarda les deux formes qui lui faisaient face, énormes, formidables et qu’il distinguait à peine en contre-jour. Il jeta un coup d’œil circonspect autour de lui pour la énième fois, ne voyant rien de particulier que cette pièce vide, blanche, extrêmement propre et baignée de lumière. Il s’agita sur sa chaise qui craqua et puis enfin, ramena en se redressant les mains sur la table de chêne parfaitement lisse qui le séparait des deux autres. Il soupira et tout son corps se détendit. Ses épaules se relâchèrent et son buste s’affaissa. D’une voix plus posée, il prit la parole.
- Bon, très bien.
- Génial !
- Jean.
- Pardon, pardon.
- Je m’en souviens comme si c’était hier. Le sentiment de honte était tel que...
- Non, non, non, coupa la voix de gauche qui semblait commander, ça c’est la fin. Vous devez recommencer depuis le début.
Il leur lança un regard lourd.
- Mais je commence où je veux. C’est mon histoire. Et tâchez de ne plus m’interrompre.
Ils gardèrent le silence.
- Donc. Je disais. Je l’avais tué. Des années après, j’apprenais sa véritable identité comme ça, sans prévenir. Je sentis tout mon sang refluer de mon visage ; mes membres devenir lourds, si lourds qu’il me semblait que j’allais tomber. J’avais une conscience si aiguë de tout mon corps. J’en sentais la moindre veine, la moindre artère pulser effroyablement, comme si elles allaient éclater, comme si mon sang allait jaillir en torrents et s’échapper pour abreuver la terre qui criait vengeance. Une chaleur épouvantable m’enserrait la gorge. Je suffoquais. Il me semblait entendre se rapprocher tous ensemble des cris d’oiseaux effrayants et des battements d’ailes, la note aiguë et assourdissante d’un millier de serpents qui sifflaient de concert. Je me suis assis. Je reprenais doucement conscience de ce qui m’entourait. Le soleil me martelait le crâne de ses coups. J’étais trempé de sueur. Les mains fébriles. J’avais envie de vomir. J’y repensais encore et encore ; je ne pouvais me détourner de cette vérité qu’on m’assénait : j’avais été coupable, à mon insu. Je voulais partir loin, loin, loin de cette cité dont j’avais gagné la couronne. Disparaître. N’être jamais né. Et puis la colère. Une immense colère s’est soudainement allumée en moi et ronflait comme un brasier dans un foyer que je ne voyais que comme un volcan, attisé par un soufflet titanesque. On m’avait bien eu ! Qui ? Qui était responsable ? La Providence. Le hasard. Mes parents, ceux qui m’avaient élevé. Je blâmais la route d’avoir été si étroite. Je blâmais mon père, ce vieil âne, pour avoir été si fragile. Quelle injustice ! J’étais comme celui qui s’aperçoit soudain avoir été joué, qu’il a perdu contre un adversaire aux dés pipés. Je pris une pierre et la fracassai par terre. Une autre et la lançai contre la falaise de toutes mes forces. Je me mis à genoux et labourai la terre de mes poings, la griffai jusqu’à ce que mes ongles se déchaussent. Je me frappai le front contre le sol, pleurant comme une source de montagne, bavant comme le Cerbère, comme trois. Mais rien n’y faisait. Je l’avais tué, misérablement, d’un coup, sur cette route sordide qui menait à Corinthe, comme aurait pu le faire un simple maraudeur pour quelques piécettes ; pire, parce qu’il avait refusé de me céder le passage, à moi, fils de roi ! Alors, je suis resté là, à sangloter jusqu’à la tombée de la nuit, prostré. Puis, sous le couvert apaisant de son manteau, comme le froid d’une lame rafraîchit le front, je remontai au palais la nuit.
J’allai dans mes appartements, évitant chaque sentinelle, chaque serviteur, saisis le stylet et me crevai les yeux.
Il se prit la tête entre les mains et se tut. Des larmes laissaient de fines traînées brillantes dans sa barbe.
- Je suis désolé, dit Pierre doucement, Je sais que c’est difficile d’en reparler, c’est comme tout revivre. Mais je vous assure que l’effet en est positif. Vous voulez un verre d’eau avant de continuer ?
L’homme ne répondit pas. Il sanglotait. Jean brisa le silence. Pourquoi les yeux ? demanda-t-il, et Pierre qui s’énerve, Quoi ? Ça te suffit pas ? C’est pas ça, il y a un truc que je comprends pas. Et Jean parla d’oreilles à couper, d’amputation diverses et variées, de sepukku et d’émasculation. Il insistait : Pourquoi les yeux ? Pierre y réfléchit à voix haute, tout en faisant la grosse voix pour tenter de faire peur à Jean, cet incorrigible irrévérencieux. Il aligna plusieurs raisons pêle-mêle, comme quoi c’était pour ne plus voir l’insoutenable vérité, pour ne plus risquer de regarder sa mère ou ses proches dans les yeux, pour ne plus pouvoir désirer la seule chose qui lui était interdite, se castrer en somme, métaphoriquement, comme aurait dit l’autre. Cette dernière mention remua un peu le vaste océan de vase qui constituait la mémoire de Jean, et qui, comme pour tout bon gratteur de papier, était à majeure partie constituée de pensées immédiates et superficielles. Il faut bien le dire. Vous ne trouvez pas ? Il dit, avec un air de sage, que ce n’est pas le désir incestueux qui est à l’origine du parricide et de l’inceste ni même qui remue les tripes de tout un chacun mais tout simplement un désir qui copie ceux d’autrui. Qu’est-ce que tu veux dire ? La raison est simple et il s’agit de l’expliquer clairement. L’homme connaît un vide existentiel : il désire l’être, être au monde, l’absolu en somme. Mais comment y accéder ? Que désirer, parmi la vaste majorité des choses qui composent le réel ? Tout simplement la même chose que son prochain. L’autre, parce qu’il désire quelque chose, a l’air supérieur, plein et entier ; l’objet de son désir ne peut donc qu’être d’une importance capitale : c’est cela, le chemin vers l’absolu ! Ainsi, notre ami ici présent ne désirait pas vraiment coucher avec sa maman ni tuer son papa, mais il ne faisait que copier le désir de la figure paternelle. Et donc, désir incestueux, cela revient au même, mon pauvre Jean. Mais non ! Parce qu’à l’origine de ce désir, il n’y a pas de violence, puisque c’est uniquement par mimétisme que l’on désire ; contrairement à ce qu’on a pu avancer, l’homme n’a donc pas de désir de mort, ni de véritable pulsion qui guide ses actes : il n’a pas un objet défini vers lequel il se tourne, il copie, c’est tout. La violence vient après, en réponse à ce refus de la société qui dit : désire ce que je désire, mais ne désire pas ce que je désire. Ainsi, se crever les yeux, c’est briser ce cercle infernal, c’est refuser de voir ce que l’autre désire, c’est en définitive ne plus être un homme et devenir un monstre ou un homme au-dessus des autres, ce qui est la même chose. Les yeux, c’est le symbole du mimétisme : tu vois et tu imites. Même si personnellement, lui, Jean, pensait que c’était aussi parce que c’était quand même bien plus pratique à crever que des mains à amputer ou des attributs masculins à émasculer. Merci ! pour ce petit point théorique. Que ce n’est rien. Puis le silence se fit de nouveau. L’homme n’avait pas cessé de sangloter pendant tout leur échange, qui avait duré vingt bonnes minutes. Ce fut Pierre, cette fois, qui rompit le silence.
- Mais..., dit-il, d’un ton hésitant, vous ne l’avez pas évoquée, justement, votre mère ?
- Ou plutôt votre femme, dit Jean.
- Ou plutôt votre femme, dit Jean.
- Ce n’est pas la chose à dire, Jean !, dit Pierre en haussant la voix.
- Coupez !
Tout le monde soupira dans la salle.
- Non ! Naze ! Tant pis ! On y reviendra. Scène suivante : Jocaste fait son entrée et va réconforter Œdipe dans une scène poignante. Top départ !
Et en fin de journée :
- Les cocos. Briefing. Jacquie, très bien les larmes, bonne initiative, mais c’est marqué « Pleure à chaudes larmes » ; les pleurs, il faut sangloter vraiment, hein, chouiner presque. Faut le faire pleurer aussi, le spectateur. Là, c’est-à-dire qu’on est avec un personnage qui regrette, qui se ronge les sangs, qui s’est rongé les sangs jusqu’aux os si j’ose dire.
- Oui, mais...
- Parce qu’Œdipe, c’est quoi ? Moi, je dirais : c’est le remords, le remords pur, d’accord ? Le gars, il regrette tellement qu’il se crève les yeux, tu vois ? C’est son châtiment volontaire, c’est l’aveuglement volontaire, le vide désiré, l’évidement de sa personne pour ne plus faire qu’un avec le grand tout. Il s’embaume lui-même le mec, tu comprends ?
- Oui, mais justement...
- Mais c’est pas seulement pour plus y voir, pour plus rien comprendre au monde, au contraire, il comprend tout, mais c’est pour ne pas continuer. Œdipe, c’est le bout du rouleau. Et pourtant, il va continuer dans le malheur. Et que je te tue ses fils qui s’écharpent entre eux, et que je t’emmure ta fille vivante... Tu comprends ?
- Oui et...
- Attends, je vais t’écrire tout ça sur un tipapier. chouiner... châtiment... bout du rouleau... J’abrège en BDR. Voilà. Tiens, prends ton tipapier.
- Merci. Et pour le...
- Et puis Œdipe, c’est la douleur aussi. C’est les larmes mais aussi des cris. Il faut faire mieux que Castellucci, Jacquie, là.
- Oui, bon...
- Donc voilà, conclusion du schmilblick : ne pas hésiter à aller dans la caricature. Oublier l’adolescent torturé à la petite semaine. Déchirer l’espace-temps. Mais c’était bien, continue comme ça fiston.
Ils partirent tous et seul resta le jeune avec sa fausse barbe blanche. Les énormes néons s’éteignirent l’un après l’autre ; resta la faible lumière de la lampe du metteur en scène, accrochée à son siège. Il était debout, les bras ballants et immobile, écrasé sous l’énormité de sa tâche.
Au-delà de la Lune, au-delà de cette frontière qui, lorsqu’on la franchit, nous fait entrer dans le monde supralunaire des planètes et des soleils, les astres tournent invariablement ; ces gros corps, trop immenses pour que l’esprit humain puisse les embrasser d’un seul coup d’œil, doivent être fragmentés, à regret peut-être, en données, masses volumes, pressions et calculs, à moins d’en être très éloignés ; ils vibrent dans le vide, résonnant tous ensemble comme les cloches d’un troupeau ; ils jouent des rayons lumineux, des reflets et des gaz pour former une chorégraphie parfaitement ordonnancée, prévue depuis des millénaires ; ils poursuivent leur course inexorable et ennuyeuse.