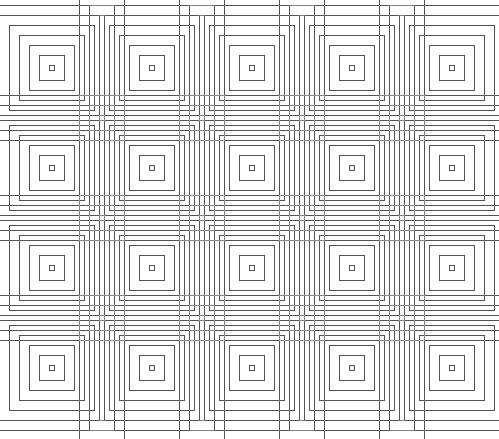
HENRI BARBUSSE
L’ILLUSION
Flammarion, 1919
"Henri Barbusse. L’Illusion. Paris. Ernest Flammarion, éditeur. 26, rue Racine, 26. Droits de traduction, d’adaptation et de reproduction réservés pour tous pays.
L’ILLUSION
HENRI BARBUSSE
Flammarion, 1919
Extrait des nouvelles de Henri Barbusse
Mis en page par Hortense Driguet
dans le cadre du workshop de Julie Blanc
— du 27 au 29 octobre 2021
L’Illusion
Quoique il dût faire encore jour, il n’y avait plus de soleil. Le brouillard et la pluie bretonne nous avaient surpris au milieu d’une excursion en pleine mer. Il nous semblait que la pluie fût tombée ainsi depuis la création du monde, et du pont humide du bateau qui tirait des bordées le long de la côte, nos visages regardaient aveuglément au loin...
Notre ami Saintclair, qui avait un doux regard sous son capuchon de toile cirée, désigna, avec l’aile ruisselante de son geste, la côte basse et noyée, à peine visible dans l’espace :
— C’est La Chapelle, dit-il. Quand j’étais enfant, je passais mes vacances sur cette dune alors ensoleillée et pleine d’été...
Et à sa voix, comme un groupe de naufragés jetés au fond de cette longue barque de brouillard, nous levâmes malgré nous nos yeux perdus vers le miracle du soleil qu’il évoquait.
Le vent nous obligeait à décrire de longs circuits pour nous éloigner peu à peu de la côte qui s’étend entre l’anse de Malen et le phare du Pouldu. Une manœuvre fit tourner le bateau ; un souffle nous fouetta la figure ; la grand’voile battit le long du mât, puis nous recommençâmes à fuir en sens inverse, pauvres voyageurs éternels du gris. Le vrai soir tomba, et comme nous nous étions rapprochés tous les trois, solitaires, sans avenir, à cause de cette pénombre, le vent suspendit son bourdonnement éternel, et s’enfonça dans le silence.
La voix du capitaine Hublot ordonna d’allumer le falot. Au loin, vers La Chapelle, on distinguait une église, des maisons, que le couchant morne et fumeux jaunissait dans le déluge. Tout près, la lueur du falot tremblait sur l’inconnu de la mer.
C’est alors que Saintclair nous raconta une histoire d’enfance, que tout, autour de nous, nous aida à comprendre.
Au commencement, dit-il, comme dans la Bible, quand je pense profondément à moi, je me vois errer tout seul pendant d’interminables journées dans ce village qui ressemblait à tous les villages, mais qui, pour moi, avait une figure.
Je faisais mes études au collège, à Rennes, où je suis né d’un père normand et d’une pauvre mère bretonne... Orphelin depuis l’année de ma sixième, au milieu de laquelle j’étais revenu parmi mes camarades, grandi et pâli après la dernière maladie de mon père, j’avais pour tuteur un gros commerçant de la ville, jadis en affaires avec ma famille. Il s’occupait honnêtement de moi le long de l’année. Pendant août et septembre, il m’envoyait ici — là-bas — chez ma vieille tante maternelle ; elle est morte à la fin de l’année dont je vais vous parler : sa figure d’alors est sa figure de toujours...
La bonne dame aimait à rêver dans la salle basse de sa maison demi-bourgeoise qui donnait sur un chemin, puis sur des champs, par deux petites fenêtres mal ajustées, et, à l’opposé, sur une rue du village, par une grande baie triste à ancien encadrement ogival. Ce village dont je vous ai montré du doigt tout à l’heure, au loin, le fantôme, était en haut d’un plateau qui venait mourir sur la dune. De la dune au village, un chemin montait ; on l’appelait le chemin des Tamaris ; on l’appelle encore ainsi sans doute, car les habitudes des villages sont bien tranquilles. Je revois ce chemin — le soir, — étroit, raide, pesant, où souvent les vieilles glaneuses crépusculaires laissaient tomber un peu d’or, comme pour de plus pauvres qu’elles... Je le revois aussi à l’aube, pur et blanc dans la fraîcheur vivante où j’allais non sans émotion, car à la pointe du jour, avant que les hommes ne soient tout à fait réveillés, les choses sont presque comme des anges.

Ma tante n’astreignait pas à sa vie sédentaire et abandonnée dans une chambre, la jeune âme de douze ans que j’étais. Je ne possédais pourtant pas un caractère remuant ni joueur, mais j’ai toujours eu — et cela est triste pour un être vivant — besoin de liberté. Très contemplatif, d’une contemplation qui tournait en mélancolie, avec mon cou frêle, ma figure de fille, j’étais ébranlé par le spectacle des choses, j’aurais voulu faire des statues effrayantes, et il m’a fallu du temps pour comprendre qu’il n’y a rien de plus effrayant que de raconter doucement et scrupuleusement la vie. Au surplus je n’avais pas beaucoup vécu : je n’avais pour trésor, au fond de moi, que le souvenir mourant de mes parents, de quelques amitiés et maisons quittées, que le sourire de ma vieille tante, sourire que je savais toujours là, à m’attendre ; et cette espèce de gloire qui m’a dévoué trop jeune, trop seul, c’est-à-dire trop pauvre, hélas, au martyre de contempler.
Un soir que je faisais une commission au village, je rencontrai une petite fille angélique dans l’ombre d’une boutique de mercière. Sur le fond de casiers en bois noir et de cartons sombres qui se dressaient le long des murs, assise sur un escabeau, elle attendait sa mère, une moitié de la figure éclairée par le ciel...
Le lendemain, à l’heure brûlante et ensoleillée où l’on rentre déjeuner, je vis la même petite fille s’avancer vers moi, sur le tiède sable croulant, le long de la mer qui lançait de doux éclairs. Elle avait de grands yeux bruns, mais d’un brun glauque, profond, sous-marin. Ses cheveux d’or revenaient comme un voile sur un côté de son blanc visage ; son front brillait comme une grande perle. Le soleil, qui était juste derrière elle, faisait une ligne dorée tout autour de sa tête, et jusque dans ses mains qui pendaient le long de sa jupe marron, avait mis sa vie pure. Je lui dis bonjour en touchant mon béret. Elle me sourit et je m’étonnai de ce sourire.
Comme le village de La Chapelle n’était pas fréquenté, ainsi qu’il l’est maintenant, sans doute, par des touristes ou des baigneurs, il était très naturel que ses rares habitants de passage se rencontrassent souvent. C’est ce qui arriva pour moi et la petite fée humaine. Nous nous considérâmes, puis nous échangeâmes quelques mots, puis nous nous interrogeâmes. Son histoire était plus simple encore que la mienne : elle habitait Paris, l’hiver ; elle était venue pour quelque temps avec sa mère ; elle avait un grand frère, parti en colère il y avait longtemps, et qui reviendrait peut-être un jour... Elle n’était pas venue l’année précédente. Retournerait-elle l’année suivante ? Elle ne savait pas : sa mère non plus ; personne au monde ne savait.
Nous nous habituâmes à sortir tous les deux. A vrai dire, je ne comprends pas très bien, maintenant que j’y réfléchis, comment on pût laisser partir seule cette petite fille dans un pays accidenté et dangereux par endroits. Après tout, il y avait peut-être quelqu’un qui nous suivait parfois, mais je ne me rappelle plus...
Peu à peu, il s’établit entre moi et l’enfantine jeune fille, une grande et frissonnante amitié. Ce fut d’abord, de mon côté, de l’admiration. Elle me paraissait si belle et si lointaine, cette petite bouche avait des paroles si, grandes, un silence si vaste ! Elle souriait gravement, ce qui est doublement sourire. Je la regardais longtemps. Je l’écoutais. Elle parlait peu, quoique sa voix fût fine ; il semblait qu’elle ne fît entendre cette petite voix que lorsqu’elle avait trouvé quelque chose digne d’être mis en musique. Et tout en elle, jusqu’à son souffle, me charmait.
Bien souvent, dans la plaine, je l’attendis avec ravissement, et parfois, à l’heure où le jour décline, dans un décor d’herbe morne et de chaumière grise, je l’aperçus, émergeant d’un ravin sombre, dorée, et comme égarée d’un scintillant jardin, et le jour semblait quitter sa tête plus lentement que le monde...
Nous habitions, probablement, non loin l’un de l’autre. Nous rentrions ensemble au fond de la brune tiède, mordorée et heureuse. Nous montions le chemin des tamaris qui, en haut, s’élargissait en avenue, et nous nous avancions sous l’immense dôme de peupliers vermeils au soir et dans un alignement religieux. Si je tournais et baissais la tête vers elle, je voyais ses cheveux rougis par les rayons horizontaux et poudroyants qui enfilaient l’avenue. Elle cheminait à côté de moi, docile, toute puissante, telle qu’elle m’apparaît à présent dans les cieux inaccessibles du passé avec, autour d’elle, la pudeur infinie de son nom oublié...
Saintclair s’arrêta. Nous devenions indistincts les uns aux autres, la place de la figure plus sinistre dans l’ombre. Il était là, en face de moi, les bras croisés, immobile comme s’il s’était tu depuis longtemps.
Du froid tombait avec la nuit sur le bateau, et finissait par nous secouer avec son calme. Nous nous levâmes et nous nous réfugiâmes dans l’étroite cabine, où nous nous trouvions un instant après, serrés, dans l’éclairement jaune de la lampe fixée à la paroi, et dont nous avions par instants, dans les yeux, la flamme brillante et le réflecteur, et Saintclair continua, nous donnant doucement ce qu’il voyait :
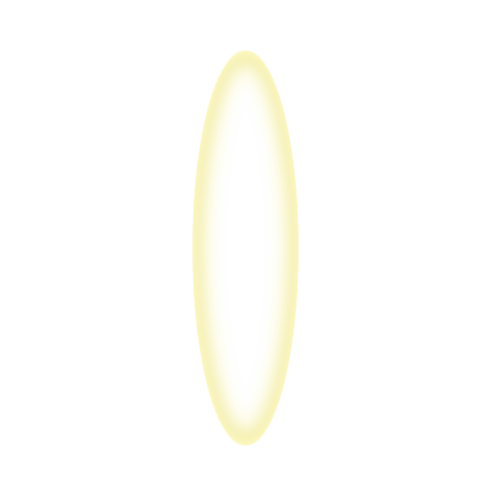
C’est comme un vrai rêve : je le sais sans le savoir ; je crois... Les maisons de la grande rue me connaissaient, et chacune avait l’air de s’avancer avec moi quand je passais. Un boutiquier du coin de la place avait fait peindre sur son enseigne quelque chose d’extraordinaire, mais je ne sais plus quoi... Il y a bien longtemps, bien longtemps, de cette époque ; les femmes des villes portaient des coiffures qui paraîtraient tout à fait surannées aujourd’hui, et tous les rires d’enfant que nous entendions sont devenus des malheurs !
Je vois mal, mais je vois au loin, parmi tous ces souvenirs qui sont à présent si fatigués, un vague et grand bonheur, un don de comprendre et d’admirer, à cause de la petite main mignonne que je tenais dans ma main... Tout s’ouvrait à mes yeux. Les choses quotidiennes me montraient leur trésor quotidien ; je découvrais d’admirables simplicités : je sentais auprès d’elle, que la terre est profonde, et qu’en somme, au-dessus de nos têtes, les cieux sont toujours grands ouverts.
Bien des jours, côte à côte, tandis que les bonnes gens se demandaient peut-être ce que nous pouvions bien ne pas nous dire, nos pensées se purifiaient, montaient ; nous ressentions confusément les grands préludes des choses qui ne sont pas faites pour s’achever en ce monde. Puis notre attention se précisait, descendait amicalement sur les choses, puis sur les êtres : notre cœur, béni — bénissait.
Nous connaissions quelques pêcheurs, quelques bonnes femmes ; parmi elles, une vieille dame, la sœur du curé. Cette dame qui fait partie de l’histoire à laquelle j’arrive sans en avoir l’air, — comme dans la vie, — était la dévote du lieu. Elle regardait loin devant elle. Elle avait une voix de cantique qui, semblait-il, n’oubliait jamais complètement le bon Dieu.
Sa maison était, avec deux ou trois fermes, la seule qui fût bâtie en pleine dune, à la place où s’élevait jadis, dit-on, l’ancien village envahi par les sables. Le vent, à cet endroit, battait les ajoncs comme, plus bas, le flot battait les roches ; mais la maison entourée d’un enclos, puis d’un mur, était si tranquille et si close qu’elle avait, elle aussi, avec l’église, un lien de ressemblance et de parenté.
Nous ne passions devant cette demeure qu’avec respect et appréhension. C’était un endroit si sage qu’il était défendu. Et pourtant la dame solitaire qui l’habitait était pour nous comme une vieille sœur parmi les autres ; elle adorait, et nous aussi nous adorions...
Autant qu’on peut être sûr de ce qui n’est plus, j’ose dire que j’ai aimé ma petite compagne et qu’elle m’a aimé. Que nos douze ans ne vous fassent pas sourire. On ne peut pas comprendre de quelle douceur démesurée est plein un cœur d’enfant. Pourquoi des enfants ne s’aimeraient-ils pas ? Qui pourrait assigner un âge aux signes les plus mystérieux de l’amour : à cette sensation de renouvellement universel qui fait que le soleil lui-même semble s’être illuminé, à ce frisson qu’on éprouve, quand on voit ce que l’on trouve beau se diviniser de caresse !...
Est-il besoin de le dire ? Notre amour qui s’exprimait en vague enthousiasme ne se nomma jamais. Nous avons su que nous aimions beaucoup sans savoir que nous nous aimions. Nous étions d’ailleurs ignorants et ingénus : elle bien que fort subtile, moi bien que mûri d’esprit, nous ne connaissions rien de la vie.
...Bientôt un changement se montra dans notre allure. Nous fûmes vis-à-vis des autres plus silencieux, plus méfiants, plus rebelles. Lorsque je regagnais la demeure de ma tante, quand la porte que j’ouvrais jetait un reflet sur le bahut enfumé aux ferrures de cuivre, il me semblait que j’étais encore dans son regard, et que cela devait se voir ; et, gêné devant ma tante, cette étrangère, je m’y repliais à l’écart, comme dans une aile.
...Une fois, un matin, dans un chemin vieux comme le monde, elle me retint de ses deux mains et se haussant vers moi, elle m’embrassa avec la ligne de ses lèvres. Une autre fois que je m’étais piqué au doigt, elle dit : notre sang.


Un jour, août finissait... A un déclin de lourd après-midi, entre moi et celle qui n’avait été jusque-là que ma sœur, il y eut comme un premier frisson terrestre. Sur la dune que le soleil illuminait et que l’herbe et les fleurs ornaient de leurs rayons moirés, une colline proche étendait sur nous un manteau auguste d’ombre. Nous nous regardions, ignorants, suppliants. Son visage, si perdu maintenant, avait des yeux cernés, et des perles de sueur au front. Elle était adossée debout, contre un contrefort herbeux, la tête appuyée en arrière. J’étais assis en face d’elle. Peut-être à cause de la lumière encore éclatante d’alentour, nous sentions plus profondément que jamais, la volupté d’être cachés.
Je fixais ses petits pieds sur le bord du soleil, — parmi les fleurs, ses petits pieds poétiques ; mais le sang me bourdonnait aux tempes et mes yeux, malgré eux, voyaient ces pieds charnels, remontaient aveuglément parmi toute la personne de mal et d’inconnu, dans l’ombre de la jupe ; plus encore, vers l’ombre d’un cœur parmi la chair... Nous étions là, en détresse, écrasés d’ignorance, mais en proie au grand besoin indistinct de désobéir.
Comme je baissais la tête, j’aperçus, par terre sa poupée.
Cette poupée ne ressemblait pas physiquement aux autres poupées, elle était, elle et sa robe en bois bruni et sculpté ; elle avait les bras collés le long du corps, une attitude raide et de larges pieds. Mais son âme était celle de toutes les poupées ; depuis des années, la petite chose vivante avait recueilli le passé que l’enfant lui racontait, passé de nativité, de berceau et de portes blanches qui s’ouvrent avec joie, pensées ingénues, douceur à peine mûrie, caresses ne voulant que tenir chaud. C’était bien la vraie poupée d’enfance, la toute petite créature avec son innocence grande comme l’aurore, par qui le mystère maternel ne montre que son sourire, la fleur qui ne sait pas le secret qui fait tes fleurs.
A la vue de la poupée, je sentis monter en mon esprit tourmenté une haine éperdue de l’enfance, un besoin de briser le passé derrière nous, pour renaître.
Elle gisait à terre, déjà très abîmée, très usée par la longue caresse ; et je dis : « Elle est morte ! » — et je répétai : « Elle est morte ! »
C’est alors que, dans l’état où nous nous trouvions, tentés par ce que contient de défendu l’idée de la mort et de l’ombre, il nous prit l’envie invincible que la poupée fût en effet, morte, et qu’il fallait l’ensevelir, une nuit.
Nous ensevelîmes la poupée, la nuit même, qui fut étrange et douloureuse.
Chacun chez nous, nous nous levâmes, nous arrachant aux tièdes approches du sommeil. Nous nous vêtîmes, et à tâtons, poussant les portes qui ne résistèrent point, nous quittâmes l’un vers l’autre les deux maisons où dormaient nos parents innocents, et nous nous rejoignîmes dans les ténèbres.
J’étais à sa porte. Nous nous reconnûmes avec hésitation, angoissés parce que nous étions changés, et parce que nous étions les mêmes. Nous ne savions pas ce que nous faisions ; nous étions effrayés d’avoir osé entreprendre notre rêve et de le poursuivre pas à pas ; mais nous étions emportés dans la soif de mal faire ensemble, de commettre un péché seul à seule, afin de tenir l’un à l’autre par une sorte de profondeur.
Elle me présenta la morte, et je distinguai une longue forme blanchâtre, enveloppée dans quelque linge — mais elle voulut absolument la porter elle-même, fiévreuse pourtant, haletante, pleine de la peur de la mort.
Nous descendîmes la rue du village, la solitude et le calme rendaient nos pas très sonores, de sorte que nous avions l’impression que les choses écoutaient. Cela pressa notre marche, Après la ferme du coteau (des souvenirs défunts ressuscitent ce soir), elle s’engagea sur le sentier des tamaris, où je descendis à sa suite. Elle allait comme éplorée à la fois et résolue — et je la voyais de temps en temps se pencher sur l’informe poupée bien-aimée...
Puis le sentier s’épanouit dans la dune. Comme elle me devançait de quelques pas, elle m’attendit en bas se retournant, fantôme vague avec un sourire invisible. Sa main brûlante et tremblante se joignit à la mienne, elle m’entraîna et, dans notre paradis terrestre du jour, nous allâmes, nous serrant de plus en plus, comme un couple chassé. La mer qui formait à notre droite, dans la nuit, deux ou trois grandes lignes brillantes, avait une plainte qui approfondissait encore plus que là-haut, le silence, le silence sublime, profond, qui est la musique de la vérité.
Nous atteignîmes, marchant toujours droit devant nous, le long des grèves où le vent commençait à se soulever, à se déchaîner — un mur entourant une maison dont on voyait dépasser le front à la lueur stellaire. C’était le jardin de la vieille dévote dont je vous ai parlé... Nous nous arrêtâmes enfin ; la même idée nous vînt. Il fallait violer cette demeure un peu sacrée, troubler ce benoît sommeil, de notre présence criminelle, y enterrer la morte...
Nous franchîmes, je ne sais comment, le mur. De l’autre côté, dans la jardin, le bruit de la mer s’était éloigné à l’infini, et nous nous trouvâmes entre les frissons du vent, de plus en plus seuls. Mes mains aveugles touchèrent la margelle et la ferrure d’un puits et, un peu plus loin, dans l’opacité des ténèbres, une cabane de planches dont la porte traînait, l’épaule disjointe. Des instruments de jardinage y étaient remisés, je remuai ces décombres et en soulevai, tendant les bras, une bêche. J’attaquai le sol, n’importe où. Elle eut un rire sec, presque méchant, quand elle devina que j’abîmais le jardin qui n’était pas à nous ; puis, elle se tût.
Mes yeux qui essayaient de fouiller la terre avec la bêche, se levèrent ; je voyais un peu mieux. Au pied du sombre mur, émergeant à peine distinctement dans l’aurore des étoiles, elle regardait, brillait, blême et bleue, et ses lèvres brillaient comme ses yeux. Elle tenait la petite créature et, me penchant vers elle, essayant de voir, il me sembla que dans un frisson de haine et d’amour, elle lui serrait le cou de ses doigts d’ange.
Quand j’eus creusé, elle posa le cadavre dans l’eau miroitante au fond du trou, afin qu’il fût mangé par la terre que je rejetai par-dessus.
C’était fini, elle s’assit sur un tronc d’arbre abattu qui était là. Je me mis à genoux près d’elle pour mieux la voir. J’approchai ma figure de la sienne qu’il me sembla découvrir pour la première fois, tragique.
Oui, quelqu’un ou quelque chose était mort, il y avait entre nous un vide nouveau qui s’élargissait, nous préparant un vertige. Elle me serra le poignet de toutes ses forces, et nous nous étreignîmes l’un l’autre, nous demandant comment les hommes se fouillent pour se trouver le cœur...
Ce soir, aventurés près de la mort et comme abandonnés de nos parents, nous entrevîmes que notre vie était plus grande qu’avant, nous pressentîmes qu’il y avait des crimes qu’on nous cachait, et qui se traînent dans des lits de ténèbres, nous devinâmes quelque immense plaie humaine, et elle apparut à mes yeux, le temps d’un éclair, femme éternelle, saignante, et le cœur aux lèvres.

Puis, pauvres petits promeneurs du froid, nous avons eu peur d’un enfer. Nous nous sommes levés ; j’ai lancé la bêche à travers le jardin ; nous avons poussé la porte, et, la laissant ouverte derrière nous, nous sommes sortis de l’enclos profane où nous avions à moitié perçu le cri des hommes et des femmes.
Ce fut septembre, la pluie ; et quoique l’heure de la séparation approchât, nous dûmes rester enfermés chez nous sans nous voir, à cause des chemins impraticables.
Oh ! bien des fois, le front aux carreaux, dans les jours de plus en plus courts, je pensai à elle en présence du ciel uniformément gris, de la pluie qui tombait sans discontinuer, de toute la dune détrempée, balayée par les larges brises marines. Sur la route, des parapluies qui filaient, des voix confuses dans la bruine et les flaques, et, de temps en temps, ies bonnes charettes qui passaient en parlant aux vitres...
Déjà s’emplissaient les malles pour le départ, se dénudait ma chambre où rôdaient la femme de ménage et ma tante, fraternelles à mes yeux comme si ma candeur d’enfant récompensait la vieille servante, et qui sont à présent deux ombres tout à fait semblables, car vous l’ai-je déjà dit ? elles devaient toutes deux mourir dans cette année-là. J’entrais dans la cuisine, pleine d’une buée, puis je revenais dans la grande chambre, mal meublée d’un buffet et de rangées de chaises, toute triste aussi, comme si elle était un monde. Et machinalement, je retournais vers la fenêtre, Oh ! bien souvent aussi, je voulais prendre mon capuchon d’écolier, sortir à la pluie, je voulais aller vers elle errante aussi parmi une chambre. Puis, lorsque le soir emportait à jamais la journée, j’avais envie de pleurer dans un coin, pleurer tout le temps perdu et tout le temps qui se perdait. Je m’imaginais que c’en était fait, que tout finirait avec cette saison déclinante, que je ne la rencontrerais plus qu’une fois, à la hâte en costume de voyage, et que dans l’oppression du départ, je la regarderais sans la voir.
...Nous nous revîmes pourtant. Je me souviens de notre promenade d’éclaircie, presque la dernière de toutes, La mer, au loin s’étendait jaune. Un long vent doux passait sur l’étendue consolée ; la brise de terre était une odeur humble d’herbe qui venait caresser la grande amertume de la mer.
Des inquiétudes d’amour, nos troubles s’étaient comme élargis et pardonnés. Je l’aimais plus saintement qu’une sainte, plus timidement qu’à la première apparition d’elle... Je ne puis vous décrire ses traits. Je sais qu’elle avait ce soir-là un fichu de laine noire noué dans le dos et un grand chapeau de crêpe noir, à larges bords ; je sais aussi que nous allâmes du côté du petit bois, sur les sentiers de sable, de boue et de feuilles mortes, encensés par l’automne.
Nous parlâmes de l’année suivante. Nous essayâmes d’engager l’avenir avec nos volontés. Mais, et c’était là notre mal, un grand pressentiment que tout était fini venait après chacune de nos phrases l’effacer, la rendre inutile : Nous ne nous reverrions plus. Au retour, elle s’assit sur un débris de monument druidique, et moi, accroupi non loin d’elle, je m’occupai à graver une lettre, la sienne, sans doute, — laquelle ? — sur la pierre préhistorique. La tête haute, elle regardait droit devant elle, et, tout à coup, je vis ses yeux briller puis se refermer, pleins de douceur et de larmes. Elle était pâle, très fine avec sa délicatesse surhumaine, son grand chapeau noir. De jour en jour, j’avais plus peur de l’admirer, et cet après-midi suprême, je la laissai un peu à l’écart, sacrée, avec les perles de ses pleurs...
Puis nous revînmes comme si nous avions perdu notre destin. Avec sa voix claire, elle chercha une petite chanson, le long de la route. Je me souviens des paroles et de l’air. Je la répète parfois quand je suis seul, pour essayer de m’approcher merveilleusement de ce qui n’est plus ; mais la chanson est morte, et moi, terrassé par l’angoisse de l’existence, je lui survis pourtant.
Nous prîmes sans doute, malgré le crépuscule, la sente sur le bord de la falaise, là-bas, si loin que nous ne la verrions même pas avec nos yeux du jour. Au-dessus de nos têtes, des oiseaux blafards tournoyaient et criaient. Nous marchions, un peu éclairés par un reste de lueur, dans cet assombrissement qui fait que le soir est comme une tempête calme. Et je revois, enfoui dans le temps à un endroit que je ne sais pas à plusieurs années près, ce petit couple tourmenté ne cachant pas sa tristesse, portant le deuil, et qui ne demandait pourtant presque rien, mon Dieu...
***
Encore une fois, le narrateur s’arrêta. Il avait une figure maigrie, une douce barbe brune, et de grands yeux qui ne seraient plus étonnés jamais. Nous lui sourîmes...
— « Écoutez, reprit-il, la fin de l’histoire. Une grande nouvelle emplit La Chapelle et nous bouleversa : Les pluies exceptionnelles avaient mis à découvert, dans le jardin de la vieille dame, une relique, une très vieille statue de la Vierge, croyait-on ; enfouie depuis des siècles...
Le curé avait disserté. Il m’apparaît, dans quelque intérieur de ferme, devant une table grossière, le torse moulé dans sa soutane, une main sur son genou, l’autre main explicative : c’était une église du temps des chevaliers bretons, envahie, puis recouverte par le sable, et dont on voyait autrefois le clocher en détresse dans une fondrière les jours de grands vents.
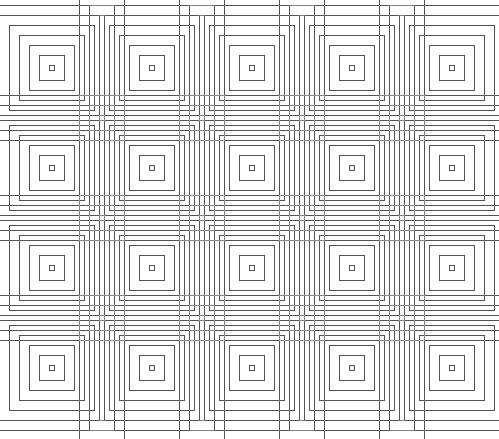
Quant à ce fait que la petite statue sacrée fut remontée précisément dans le jardin de la dame, c’est là ce qu’il y avait de beau, d’à peu près miraculeux et qui prouvait l’appel du bon Dieu. La dame était, au su de tous, fort pieuse et pratiquante, et la vertu est toujours récompensée. Il parla « d’enclos béni », de « jardin innocent » et nous qui nous souvenions de la nuit tragique, cela nous fit tressaillir plus que tout le reste. Nous pensions, tellement nous l’avions entendu répéter dans nos leçons, que les fautes finissent toujours par être découvertes ; mais les choses ne donnèrent pas raison à la naïve et pure croyance. Notre poupée ne fut reconnue par personne... Le curé nous apparût ridicule, avec son petit front, ses gros yeux, sa voix qui ne donnait pas ce grand accord de la vérité avec la vérité ; tandis que, tout autour, il était question de faire de notre jardin un lieu de pèlerinage... Et pendant quelque temps, le pays fut sous l’impression du bon Dieu.
Nous revîmes notre poupée, un instant, pendant une blanche cérémonie religieuse autour de laquelle nous rôdions désemparés comme si nous n’avions pas de place dans la foule. Elle était posée sur une serviette pliée en quatre ; elle était noire et usée, comme si à dormir dans le terrible cauchemar de la terre, les heures étaient des années. Nous avions encore peur, et nous nous taisions ; mais, malgré nous, nous n’étions pas attentifs au rite et, au lieu de regarder le prêtre, nos yeux erraient, s’arrêtant sur la bouche d’un chantre ou sur l’étonnement magnifique d’une pauvre fille des champs qui prenait part à la cérémonie dans sa robe de mousseline blanche.
Il y eut une procession, une procession de tous ces gens qui se trompaient. Elle partit du jardin poétique et brûlé par l’espace, avec son puits et sa cabane de planches, monta, blanche, le flanc escarpé de la falaise, et gagna l’église qui montrait sa façade claire derrière les arbres faunes et fragiles d’automne, derrière le mail rouillé aux bancs vides, où l’on voit sur les feuilles mortes, les curés passer comme des veuves...
Je ne me rappelle plus qu’une fois, dans le couchant... C’était à la fin de ce jour où la dame, bénie par le miracle, revint de porter ce qu’elle croyait être une relique à un haut personnage d’Église : apparemment, l’évêque de Saint-Brieuc ou celui de Tréguier... Nous étions dans un bas-fond et nous la vîmes passer, pleine d’illusion, se détachant sur le soleil précieux. Son image s’élevait entre l’astre et nous ; elle avait sa grande cape noire, marchait de son calme pas, encore embelli, et l’espace semblait à elle. Et tout d’abord, de la voir si bienheureuse, nous qui la savions pourtant si trompée, nous ne pûmes nous empêcher de sourire. Puis notre sourire s’arrêta, et se mit à penser...
Déjà une étoile commençait à scintiller dans l’azur vert, que la vieille dame marchait encore, dorée, parfaite, et que nous la suivions des yeux, groupés et perdus du côté du soir.
Ma sœur d’un jour était tout à côté de moi, un peu penchée. Je voyais une ligne blanche sur sa nuque, où le soleil avait mis un collier d’ambre, et presque rien de son profil perdu. Elle avait un peu du reflet saignant sur la joue et dans les yeux ; c’est ainsi que je la vis pour la dernière fois, petite statue vivante et frêle au seuil du grand silence de la vie.
Les champs étaient encore pourpres et violets, traversés d’ombres allongées, mais, avec l’heure, l’enfant devenait sombre et veuve, et, brusquement, sa main trembla dans la mienne, comme si elle avait senti lui venir par bouffées le froid de l’avenir d’hiver.
Doucement, nous pensâmes au dernier resplendissement d’octobre, au peu que nous étions, à l’avenir, à notre joie triste et grave qui s’éteignait dans le crépuscule et qui n’osait pas se contempler, tant elle avait besoin d’éternité ! Alors, nous sentîmes en nous quelque chose de si mortel que toute notre pitié est retombée sur nos têtes.
Nous sentîmes confusément qu’il ne faut pas dire, dans la vie : « Ceci est une illusion », car hélas, on ne peut dire de rien : « Ceci n’est pas une illusion » ; que si le secret de cette dame était en nous, notre secret, à nous, était ailleurs, et que, tandis que nous la regardions passer, la tranquillité du monde nous regardait...
Et tout à coup, comme si elle se souvenait vaguement d’un ancêtre génial, la petite fille se mit à pleurer, à pleurer sur la destinée des hommes... Cette fois-là encore, je la vois, mais après, je ne la vois plus.
***
Bien des années depuis, je suis revenu dans ce pays. Je n’ai rien retrouvé à la place des maisons de la dune : à peine, dans une sorte d’enclos démoli, une bicoque délabrée, pas bien loin d’un vieux puits. Au bord de la mer, toute la grève était à moi dans le silence... Mais il me restait, en ce premier retour, un retentissement au cœur, et je ne voulais pas croire qu’à jamais ce cœur oublierait. Maintenant, la pauvreté s’est accomplie...
L’aveu des cloches
Le printemps fleurissait sur la mer.
A vrai dire, ce n’était pas tout à fait le printemps, mais le premier des beaux jours qui se hasardent dans l’hiver, comme des apparitions, pour annoncer que la saison resplendissante reviendra et qu’on avait tort de cesser d’y croire.
Du haut du clocher, le sonneur regardait l’admirable promesse de ce matin encore captif dans les jours gris. Mais l’homme restait indifférent au spectacle de la mer pleine de facettes, jonchée de fleurs de rêve et d’étoiles légères. Que lui importait l’immense embellissement de la nature !... Il était le pauvre cœur pour qui cette richesse-là n’est plus faite.
La mer avait beau se mêler au ciel et déployer chacune de ses moires, et essayer en hâte toutes les parures que lui prêtait le soleil... Les regards de Beppo étaient hantés d’une ombre ineffaçable : celle qu’avait laissée Bianca, la plus belle des passantes, en passant et en s’en allant. Et malgré que la petite promeneuse sublime de sa vie eut disparu, son ombre était restée entre lui et toute chose, plus grande que l’Adriatique, plus grande que l’avenir, — aussi grande que le tombeau.
Voilà trois années qu’avait commencé la séparation qui ne finirait plus, — trois années que la voile orange de la barque trop précieuse, s’était rappetissée jusqu’à n’être plus qu’une feuille morte noyée dans les distances de la mer.
Et aussi vrai qu’elle était partie, elle ne reviendrait plus. Son absence était pire que la mort : elle aimait un autre homme, au nom maudit. C’était à cause d’un autre qu’elle était si coquette et aussi si jolie, avec sa bouche épanouie qui brillait parfois autant que ses yeux. C’était à un autre qu’elle consacrait ses chagrins et ses larmes ; c’était à un autre qu’il l’avait vue rire, si cruellement pour le reste des hommes, un soir, dans le paradis d’un petit champ.
Beppo était de la race de ceux qui ne savent pas crier leur mal, qui ne savent pas se plaindre, et qui savent trop bien pleurer... Il soupira, détourna ses yeux blessés par l’éclat, par la tentation de ce matin qui prouvait le retour fatal de l’été. Puis, comme la ligne noire qui se promenait, tel un maigre doigt, sur le cadran solaire cramponné au mur à pic du clocher, manquait l’heure, Beppo se leva, et il alla sonner les cloches.
Il sonna avec application, parce que c’était son travail et sa raison d’être. Comme on répète par devoir une phrase qu’on ne comprend pas ou qu’on ne comprend plus, il fit parler les géantes suspendues là-haut grandes ouvertes comme des dômes dans le dôme de l’azur. Désabusé, il semait à toute volée l’espoir parmi le doux éloignement.
Mais de sortir ainsi de lui, les grands battements prenaient une sorte de mélancolie. Malgré lui, sa résignation s’entendait dans la sonnerie qu’il faisait vivre. Ses cloches vibraient plus tristement que les autres cloches. C’était comme si lui, le taciturne, le muet, il eût grandement parlé ; comme s’il eût crié le de profundis de sa tendresse inutilisée, de sa jeunesse dont nul bonheur ne profiterait, — et qui aurait pourtant fait tant de saint amour, si la divine passante l’avait exaucé !... Il ne pouvait pas ne pas jeter au vent avec le vaste appel, un peu des cendres de son cœur.
Le reste du jour, — entre les sonneries, — il se taisait, profondément. Il n’avait presque aucun rapport avec les hommes. Juché dans les hauteurs du clocher, il était le gardien d’un phare très ancien, très discuté, auquel bien des voyageurs de la terre ne se fiaient plus. Et, tel que les gardiens des phares inaccessibles, il vivait à l’écart de la vie et des vivants, dont il avait peur, ne bougeait guère dans sa niche dont l’espace formait un des murs, — et ne quittait jamais l’église. C’est à peine si, de loin en loin, le prisonnier puni d’avoir tant aimé, avait l’occasion d’adresser la parole au signor-syndic du village, son roi, et au signor curé, son pape.
...Ce jour-là, la voix de la cloche qui allait chercher les fidèles, toucha plus que jamais une âme qui contemplait les champs au bord de deux grands yeux.
C’était la petite âme de Lazarette Moselli, une âme malheureuse entre toutes, bien qu’exquise et ornée d’une figure-d’ange.
C’est que Lazarette portait un grand rêve éteint. Ce rêve avait la forme incomparable du jeune homme étranger qui conduisait, bien loin maintenant, la voiture automobile du prince della Scalla.
Toute une saison, il avait passé sur les routes, trônant sur le devant de l’étrange véhicule, comme une figure de proue, — et toute une saison, elle l’avait regardé, appuyée sur un mur ou sur un arbre, défaillante comme un oiseau pris au piège qui voit s’avancer l’oiseleur, et n’osant comprimer sa palpitation désordonnée pour ne pas montrer son cœur. A plusieurs reprises, le beau pilote de la voiture princière lui avait parlé, et deux fois, elle l’avait vu de près, avec sa belle moustache française éployée comme les ailes d’un faucon en plein vol... Puis, il s’était envolé sur le char magique qui lui obéissait. Et c’était justement son image dont elle ne pouvait plus guérir.
Comme le monde avait changé, depuis ! Son rire avait disparu, ses paroles s’étaient raréfiées, sa destinée s’était confinée, rapetissée, autour de sa maison. Elle y vivait à l’ombre sèche de la vieille Anna, dont elle était un peu la nièce et beaucoup la servante, — et qui était paralytique, mais acariâtre. Hors de la maison obscure aux murailles claires, elle ne sortait que lorsqu’il le fallait pour aller sur le dessus de la falaise cueillir les fileurs dont avait besoin maître Mateo, l’habile herboriste, ou mener la chèvre Giralda égaliser avec perfection le velours de l’herbe tout autour de son piquet.
Elle était aussi jolie qu’avant : un deuil n’arrive pas tout de suite à effacer la beauté : le moindre rayon de soleil l’ornait comme un talisman et la faisait ressembler à une rose coiffée d’un coquelicot. Pour passer, elle était bien obligée parfois, d’écarter joliment les branches. Mais elle ne s’intéressait à rien et à personne ; elle ne voyait même pas combien son miroir était charmant, quand, d’aventure, elle le regardait en face.
Elle n’était sensible qu’à la voix des cloches de Saint-Thomas, parce qu’il lui semblait, dans la magnifique subtilité de son chagrin, y percevoir ce qui était en effet : de fins lambeaux de plainte humaine ralentissant à peine le rythme, et une impression mal définie de désolée résignation. Quoique les paroles qui rayonnaient de l’église fussent les seules qu’elle écoutait, — puisqu’elles étaient tristes et avaient raison, — Lazarette n’osait pas aller vers l’église. Elle évitait même d’emprunter le chemin au bout duquel le portrait de pierre blanche attend. Le mal de son cœur lui faisait-il honte, ou, tout au fond d’elle-même, avait-elle la crainte qu’on lui demandât d’oublier ou de regretter les jours martyrisés d’amour ?...
...C’est alors qu’à la suite des autres dimanches, arriva, comme un magnifique seigneur, le jour de Pâques.
Il commença par tant de soleil et de parfum que chacun tressaillit d’aise, — jusqu’à Scafino, le minuscule savetier qui, à sept heures du matin, s’arrêta de taper pour écouter le tumulte que faisait son cœur dans son petit torse cylindrique, — jusqu’à la vieille Anna dont un soupir remua la personne desséchée comme une robe pendue à un clou.
Et Beppo, lorsqu’il s’apprêta à sonner les cloches, dans le clocher assailli de lumière, sentit une joie tremblante, une joie étrange, une joie injuste lui gonfler la poitrine... Étonné, il ne se retrouvait plus en lui-même... Qu’était-ce que cette force nouvelle, cette espérance neuve, ces couleurs plus belles posées sur toutes les choses ?
Malgré lui, il se mettait à revivre. Il sentait, malgré le lourd passé, son cœur endormi trop tôt, se soulever et s’éveiller. Sa jeunesse s’imposait à lui, comme une fatalité, et le forçait à palpiter.
Miracle divin ou miracle humain pur et simple ?... Quoi qu’il en fût, le chant des cloches qui avait sa source en lui, fut plus vibrant et plus heureux. La grande voix planante annonça que la vie est une victoire sur la mort, et que l’espérance est une victoire sur la vie.
Et là-bas, Lazarette, en entendant ces paroles des cloches, frissonna dans toute sa jeune douleur. Elle avait ouvert sa fenêtre qui donnait sur le pré endimanché de pommiers en fleurs. L’éternelle attristée se pencha davantage vers l’abîme de clarté pour écouter la voix changée, elle se pencha, d’abord indécise, puis peu à peu. elle se mit à entendre plus, à entendre mieux...
Aussi, ce jour-là, pour la première fois après tant d’années, Lazarette alla vers l’église... Elle marcha par les sentiers, trouvant le ciel plus beau qu’elle n’avait fini par le croire. Sur sa charrette qui barrait le chemin, le gros Biasce gesticulait comiquement, et cette drôlerie la fit rire... A une petite fille qui lui disait bonjour, elle répondit : bonjour, comme si elle eût dit merci.
Elle était presque arrivée jusqu’à l’église et ralentissait, intimidée par sa hauteur, lorsqu’elle aperçut quelqu’un qui, furtivement, venait d’en sortir.
C’était lui. Il s’était décidé à quitter sa niche, à entrer en plein au milieu de la vie odorante et rayonnante, à toucher la tiédeur qui passe et les parfums qui montent.
C’est ainsi qu’ils allèrent presque l’un vers l’autre. Ils se croisèrent, et par hasard, ils se regardèrent en même temps. Le regard qu’échangèrent ces deux créatures qui ne pouvaient plus rester vaincues, un parfum enivrant de roses vint juste à point pour le faire durer un moment.
Ils étaient si semblables, avec chacun, sa moitié d’amour qu’ils durent se lire totalement pendant l’instant où leurs yeux furent mêlés...
...Toujours est-il que, quelques heures après, le soir, l’un d’eux revint là, attendit un peu, et l’autre revint aussi.
L’ombre du soir cacha sous son aile leur rougeur commune. Puis elle fit mieux ; elle qui simplifie et qui rapproche, elle leur montra que, si inconnus qu’ils fussent l’un pour l’autre, si étrangers, il y avait dans leurs figures profondes quelque chose de pareil qu’il leur sembla reconnaître ; elle leur montra qu’ils se ressemblaient un peu, non pas quand on les regardait, mais quand ils se regardaient...



Les récits qui composent ce volume sont inédits en librairie.
COLOPHON
Cette réimpression ÉFÉLÉ a été faite le 31 décembre 2014 et est composée en Rotation.
Source :
Henri Barbusse
L’illusion
Flammarion, Paris, 1919
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35217027b
Fac-similé :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1133141
Retrouvez toutes les réimpressions ÉFÉLÉ sur http://efele.net/ebooks.