

Vous avez ici gratuitement accès au contenu des livres publiés par Zones. Nous espérons que ces lybers vous donneront envie d’acheter nos livres, disponibles dans toutes les bonnes librairies. Car c’est la vente de livres qui permet de rémunérer l’auteur, l’éditeur et le libraire, et de vous proposer de nouveaux lybers et de nouveaux livres.
Mona Chollet
Sorcières.
La puissance
invaincue
des Femmes
Table
UNE VIE À SOI. LE FLÉAU DE L’INDÉPENDANCE FÉMININE
LE DÉSIR DE LA STÉRILITÉ. PAS D’ENFANT, UNE POSSIBILITÉ
L’IVRESSE DES CIMES. BRISER L’IMAGE DE LA « VIEILLE PEAU »
METTRE CE MONDE CUL PAR-DESSUS TÊTE. GUERRE À LA NATURE, GUERRE AUX FEMMES
Merci pour les conseils de lecture, les liens et les coupures de presse, les discussions et les encouragements à Guillaume Barou, Akram Belkaïd, Otto Bruun, Irina Cotseli, Thomas Deltombe, Eleonora Faletti, Sébastien Fontenelle, Alain Gresh, Madmeg, Emmanuelle Maupetit, Daria Michel Scotti, Joyce A. Nashawati, Geneviève Sellier, Maïté Simoncini, Sylvie Tissot et Laélia Véron. Bien évidemment, le résultat m’appartient et ne les engage en rien.
Merci à Serge Halimi, qui m’a accordé un congé sabbatique pour travailler à ce livre. Toute ma gratitude va à Katia Berger, Dominique Brancher et Frédéric Le Van pour leurs précieuses relectures et la justesse de leurs remarques.
Merci à mon éditeur, Grégoire Chamayou. Et un merci particulier, une fois de plus, à Thomas Lemahieu.
.png)
Bien sûr, il y a eu celle du Blanche-Neige de Walt Disney, avec ses cheveux gris filasse sous sa capuche noire, son nez crochu orné d’une verrue, son rictus imbécile découvrant une dent unique plantée dans sa mâchoire inférieure, ses sourcils épais au-dessus de ses yeux fous qui accentuaient encore son expression maléfique. Mais la sorcière qui a le plus marqué mon enfance, ce n’est pas elle : c’est Floppy Le Redoux.
Floppy apparaît dans Le Château des enfants volés, un roman jeunesse de l’autrice suédoise Maria Gripe (1923-2007)1 qui se déroule dans une contrée nordique imaginaire. Elle vit dans une maison perchée au sommet d’une colline, abritée sous un très vieux pommier dont la silhouette, visible de loin, se découpe sur le ciel. L’endroit est paisible et beau, mais les habitants du village voisin évitent de s’y aventurer, car autrefois s’y dressait une potence. La nuit, on peut apercevoir une faible lueur à la fenêtre tandis que la vieille femme tisse tout en conversant avec son corbeau, Solon, borgne depuis qu’il a perdu un œil en se penchant sur le Puits-de-la-Sagesse. Plus encore que par les pouvoirs magiques de la sorcière, j’étais impressionnée par l’aura qui émanait d’elle, faite de calme profond, de mystère, de clairvoyance.
La façon dont son apparence était décrite me fascinait. « Elle sortait toujours enveloppée dans une ample cape bleu foncé, dont le large col, claquant au vent, faisait flop-flop autour de sa tête » – d’où le surnom de « Floppy ». « Elle était aussi coiffée d’un drôle de chapeau. Ses bords souples étaient parsemés de fleurs retombant d’une haute calotte violette garnie de papillons. » Ceux qui croisaient son chemin étaient frappés par l’éclat de ses yeux bleus, qui « changeaient continuellement et exerçaient un véritable pouvoir sur les gens ». C’est peut-être bien l’image de Floppy Le Redoux qui m’a préparée à apprécier plus tard, quand je me suis intéressée à la mode, les créations imposantes d’un Yohji Yamamoto, ses vêtements amples, ses chapeaux immenses, sortes de refuges de tissu, aux antipodes du modèle esthétique dominant selon lequel les filles doivent dévoiler le plus de peau et de formes possible2. Restée dans ma mémoire comme un talisman, une ombre bienveillante, Floppy m’avait laissé le souvenir de ce que pouvait être une femme d’envergure.
J’aimais aussi la vie retirée qu’elle menait, et son rapport à la communauté, à la fois distant et impliqué. La colline où s’élève sa maison, écrit Maria Gripe, semble protéger le village « comme s’il était blotti sous son aile ». La sorcière tisse des tapis extraordinaires : « Assise devant son métier, elle méditait tout en travaillant. Ses réflexions concernaient les habitants du village et leur vie. Tant et si bien qu’un beau matin, elle découvrit que, sans s’en douter, elle savait d’avance ce qui leur arrivait. Penchée sur son ouvrage, elle lisait leur avenir dans le dessin qui, tout naturellement, se créait sous ses doigts. » Sa présence dans les rues, si rare et fugitive soit-elle, est un signe d’espoir pour ceux qui la voient passer : elle doit la seconde partie de son surnom – personne ne connaît son véritable nom – au fait qu’elle ne se montre jamais durant l’hiver, et que sa réapparition annonce de façon certaine l’arrivée imminente du printemps, même si ce jour-là le thermomètre marque encore « trente degrés au-dessous de zéro ».
Même les sorcières inquiétantes, celle de Hansel et Gretel ou celle de la rue Mouffetard, ou la babayaga des contes russes, tapie dans son isba juchée sur des pattes de poulet, m’ont toujours inspiré plus d’excitation que de répulsion. Elles fouettaient l’imagination, procuraient des frissons de frayeur délicieuse, donnaient le sens de l’aventure, ouvraient sur un autre monde. Pendant la récréation, à l’école primaire, mes camarades et moi traquions celle qui avait élu domicile derrière les buissons de la cour, obligés de nous en remettre à nous-mêmes face au flegme incompréhensible du corps enseignant. La menace flirtait avec la promesse. On sentait soudain que tout était possible, et peut-être aussi que la joliesse inoffensive, la gentillesse gazouillante n’étaient pas le seul destin féminin envisageable. Sans ce vertige, l’enfance aurait manqué de saveur. Mais, avec Floppy Le Redoux, la sorcière est définitivement devenue pour moi une figure positive. Elle était celle qui avait le dernier mot, qui faisait mordre la poussière aux personnages malfaisants. Elle offrait la jouissance de la revanche sur un adversaire qui vous avait sous-estimée ; un peu comme Fantômette, mais par la force de son esprit plutôt que par ses talents de gymnaste en justaucorps – ce qui m’arrangeait : je détestais le sport. À travers elle m’est venue l’idée qu’être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire, alors que jusque-là une impression diffuse me suggérait que c’était plutôt le contraire. Depuis, où que je le rencontre, le mot « sorcière » aimante mon attention, comme s’il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d’énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J’aime aussi l’idée d’un art que l’on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l’on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations ; elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie.

Il m’a fallu un temps étonnamment long pour mesurer le malentendu que recouvraient la débauche de fantaisie, l’imagerie d’héroïne aux superpouvoirs associées aux sorcières dans les productions culturelles qui m’entouraient. Pour comprendre que, avant de devenir un stimulant pour l’imagination ou un titre honorifique, le mot « sorcière » avait été la pire des marques d’infamie, l’imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes. Dans la conscience collective, les chasses aux sorcières qui se sont déroulées en Europe, essentiellement aux XVIe et XVIIe siècles, occupent une place étrange. Les procès en sorcellerie reposaient sur des accusations extravagantes – le vol de nuit pour se rendre au sabbat, le pacte et la copulation avec le Diable – qui semblent les avoir entraînés à leur suite dans la sphère de l’irréalité, les arrachant à leur ancrage historique. À nos yeux, quand nous la découvrons aujourd’hui, la première représentation connue d’une femme volant sur un balai, dans la marge du manuscrit de Martin Le Franc Le Champion des dames (1441-1442), a des allures légères et facétieuses ; elle semble surgie d’un film de Tim Burton, du générique de Ma sorcière bien-aimée ou d’une décoration de Halloween. Et pourtant, au moment où elle apparaît, vers 1440, elle annonce des siècles de souffrances. Évoquant l’invention du sabbat, l’historien Guy Bechtel constate : « Ce grand poème idéologique a beaucoup tué3. » Quant aux tortures sexuelles, leur réalité semble s’être dissoute dans l’imagerie sadienne et les émois troubles qu’elle suscite.
En 2016, le Musée Saint-Jean de Bruges a consacré une exposition aux « Sorcières de Bruegel », le maître flamand ayant été le premier peintre à s’emparer de ce thème. Sur un panneau figuraient les noms des dizaines de femmes de la ville brûlées comme sorcières sur la place publique. « Beaucoup d’habitants de Bruges portent toujours ces noms de famille et ignoraient, avant de visiter l’exposition, qu’ils ont peut-être eu une ancêtre accusée de sorcellerie », commentait le directeur du musée4. Il disait cela en souriant, comme si le fait de compter dans son arbre généalogique une innocente massacrée sur la base d’allégations délirantes était une petite anecdote trop sympa à raconter à ses amis. Et l’on s’interroge : de quel autre crime de masse, même ancien, est-il possible de parler ainsi le sourire aux lèvres ?
En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérés comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n’avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face. Même quand nous acceptons la réalité de cet épisode de l’histoire, nous trouvons des moyens de le tenir à distance. Ainsi, on fait souvent l’erreur de le situer au Moyen Âge, dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n’aurions plus rien à voir, alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance – elles ont commencé vers 1400 et pris de l’ampleur surtout à partir de 1560. Des exécutions ont encore eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, comme celle d’Anna Göldi, décapitée à Glaris, en Suisse, en 1782. La sorcière, écrit Guy Bechtel, « fut une victime des Modernes et non des Anciens5 ».
De même, on met souvent les persécutions sur le compte d’un fanatisme religieux incarné par des inquisiteurs pervers. Or l’Inquisition, avant tout préoccupée des hérétiques, a très peu pourchassé les sorcières ; l’écrasante majorité des condamnations ont été le fait de cours civiles. En matière de sorcellerie, les juges laïcs se sont révélés « plus cruels et plus fanatiques que Rome6 ». La distinction n’a d’ailleurs qu’un sens très relatif dans un monde où il n’existait pas d’en-dehors possible à la croyance religieuse. Même les quelques voix qui s’élevèrent contre les persécutions, comme celle du médecin Jean Wier, qui, en 1563, dénonça un « bain de sang d’innocents », ne remettaient pas en question l’existence du Diable. Quant aux protestants, malgré leur image de plus grande rationalité, ils ont traqué les sorcières avec la même ardeur que les catholiques. Le retour à une lecture littérale de la Bible prôné par la Réforme ne favorisait pas la clémence, au contraire. À Genève, sous Calvin, on exécuta trente-cinq « sorcières », au nom de deux lignes de l’Exode qui disent : « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. » L’intolérance du climat de l’époque, l’orgie sanguinaire des guerres de religion – trois mille protestants tués à Paris à la Saint-Barthélemy, en 1572 – ont nourri la cruauté des deux camps à leur égard.
À vrai dire, c’est précisément parce que les chasses aux sorcières nous parlent de notre monde que nous avons d’excellentes raisons de ne pas les regarder en face. S’y risquer, c’est se confronter au visage le plus désespérant de l’humanité. Elles illustrent d’abord l’entêtement des sociétés à désigner régulièrement un bouc émissaire à leurs malheurs, et à s’enfermer dans une spirale d’irrationalité, inaccessibles à toute argumentation sensée, jusqu’à ce que l’accumulation des discours de haine et une hostilité devenue obsessionnelle justifient le passage à la violence physique, perçue comme une légitime défense du corps social. Elles illustrent, pour reprendre les mots de Françoise d’Eaubonne, la capacité humaine à « déchaîner un massacre par un raisonnement digne d’un aliéné7 ». La diabolisation des femmes qualifiées de sorcières eut d’ailleurs beaucoup en commun avec l’antisémitisme. On parlait du « sabbat » ou de la « synagogue » des sorcières ; on les soupçonnait, comme les juifs, de conspirer pour détruire la chrétienté et on les représentait, comme eux, avec le nez crochu. En 1618, un greffier qui s’ennuie lors d’une exécution près de Colmar dessine l’accusée dans la marge de son compte rendu : il la représente avec une coiffure traditionnelle juive, « à pendeloques, entourée d’étoiles de David8 ».
Comme souvent, la désignation du bouc émissaire, loin d’être le fait d’une populace grossière, est venue d’en haut, des classes cultivées. La naissance du mythe de la sorcière coïncide à peu près avec celle – en 1454 – de l’imprimerie, qui y a joué un rôle essentiel. Bechtel parle d’une « opération médiatique » qui « utilisa tous les vecteurs d’information de l’époque » : « les livres pour ceux qui lisaient, les sermons pour les autres, pour tous grandes quantités de représentations ». Œuvre de deux inquisiteurs, l’Alsacien Henri Institoris (ou Heinrich Krämer) et le Bâlois Jakob Sprenger, Le Marteau des sorcières ( Malleus maleficarum), publié en 1487, a pu être comparé à Mein Kampf d’Adolf Hitler. Réédité une quinzaine de fois, il fut diffusé à trente mille exemplaires dans toute l’Europe durant les grandes chasses : « Pendant ce temps de feu, dans tous les procès, les juges vont s’en servir. Ils vont poser les questions du Malleus et entendre les réponses du Malleus9. » De quoi battre en brèche notre vision un brin idéalisée des premiers usages de l’imprimerie… Accréditant l’idée d’une menace imminente qui exige l’emploi de moyens exceptionnels, Le Marteau des sorcières entretient une hallucination collective. Son succès fait naître d’autres vocations de démonologues, qui nourrissent un véritable filon éditorial. Les auteurs de ces ouvrages – tel le philosophe français Jean Bodin (1530-1596) –, qui y apparaissent comme des fous furieux, étaient par ailleurs des érudits et des hommes de grand renom, souligne Bechtel : « Quel contraste avec la crédulité, la brutalité dont ils firent tous preuve dans leurs exposés démonologiques. »

On ressort glacé de ces récits, et encore davantage quand on est une femme. Certes, de nombreux hommes ont été exécutés pour sorcellerie ; mais la misogynie a été au cœur des persécutions. « Les sorciers sont peu de chose », assure le Malleus maleficarum. Ses auteurs estiment que s’il n’y avait pas la « malice » des femmes, « même en ne disant rien des sorcières, le monde serait libéré d’innombrables périls ». Faibles de corps et d’esprit, animées par un insatiable désir de luxure, elles sont censées faire des proies faciles pour le Diable. Dans les procès, elles ont représenté en moyenne 80 % des accusés et 85 % des condamnés10. Elles étaient aussi plus démunies face à la machine judiciaire : en France, les hommes comptaient pour 20 % des accusés, mais ils furent à l’origine de 50 % des procédures en appel auprès du Parlement. Alors qu’auparavant les tribunaux refusaient leur témoignage, les Européennes n’accédèrent au statut de sujets à part entière aux yeux de la loi que pour être accusées en masse de sorcellerie11. La campagne menée entre 1587 et 1593 dans vingt-deux villages des environs de Trèves, en Allemagne – lieu d’apparition et épicentre, avec la Suisse, des chasses aux sorcières –, fut si féroce que, dans deux d’entre eux, elle ne laissa plus qu’une femme encore en vie ; en tout, on en avait brûlé 368. Des lignées féminines entières furent éliminées : les charges contre Magdelaine Denas, brûlée dans le Cambrésis en 1670, à l’âge de soixante-dix-sept ans, n’étaient pas très claires, mais on avait déjà exécuté sa tante, sa mère et sa fille, et on pensait que la sorcellerie était héréditaire12.
Les accusations ont longtemps épargné les classes supérieures et, quand elles ont fini par les atteindre à leur tour, les procès se sont rapidement éteints. Auparavant, les ennemis politiques de certains notables dénonçaient parfois comme sorcières les filles ou les épouses de ces derniers, parce que c’était plus facile que de s’en prendre directement à eux ; mais, dans leur grande majorité, les victimes appartenaient aux classes populaires. Elles se retrouvaient aux mains d’institutions entièrement masculines : interrogateurs, prêtres ou pasteurs, tortionnaires, gardiens, juges, bourreaux. On imagine leur panique et leur détresse, d’autant plus qu’elles affrontaient en général cette épreuve dans une solitude totale. Les hommes de leur famille prenaient rarement leur défense, quand ils ne se joignaient pas aux accusateurs. Pour certains, cette retenue s’expliquait par la peur, puisque la plupart des hommes accusés l’étaient en tant que proches de « sorcières ». D’autres profitèrent du climat de suspicion généralisée « pour se débarrasser d’épouses ou d’amantes encombrantes, ou pour empêcher la vengeance de celles qu’ils avaient séduites ou violées », relate Silvia Federici, pour qui « ces années de terreur et de propagande semèrent les graines d’une aliénation psychologique profonde des hommes envers les femmes »13.
Certaines accusées étaient à la fois des magiciennes et des guérisseuses ; un mélange déconcertant à nos yeux, mais qui allait de soi à l’époque. Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des philtres et des potions, mais elles soignaient aussi les malades et les blessés, ou aidaient les femmes à accoucher. Elles représentaient le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avaient toujours été des membres respectés de la communauté, jusqu’à ce qu’on assimile leurs activités à des agissements diaboliques. Plus largement, cependant, toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseur de sorcières. Répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d’une quelconque manière suffisait à vous mettre en danger. Dans une logique familière aux femmes de toutes les époques, chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous : il était suspect de manquer la messe trop souvent, mais il était suspect aussi de ne jamais la manquer ; suspect de se réunir régulièrement avec des amies, mais aussi de mener une vie trop solitaire14… L’épreuve du bain le résume bien. La femme était jetée à l’eau : si elle coulait, elle était innocente ; si elle flottait, elle était une sorcière et devait donc être exécutée. On retrouve également beaucoup le mécanisme du « refus d’aumône » : les riches qui dédaignaient la main tendue d’une mendiante et qui, ensuite, tombaient malades ou souffraient d’une infortune quelconque s’empressaient de l’accuser de leur avoir jeté un sort, transférant ainsi sur elle un obscur sentiment de culpabilité. Dans d’autres cas, on rencontre la logique du bouc émissaire sous sa forme la plus pure : « Des navires sont en difficulté sur la mer ? Digna Robert, en Belgique, est saisie, brûlée, exposée sur une roue (1565). Un moulin près de Bordeaux ne fonctionne plus ? On prétend que Jeanne Noals, dite Gache, l’a “chevillé” (1619)15. » Qu’importe s’il s’agissait de femmes parfaitement inoffensives : leurs concitoyens étaient persuadés qu’elles détenaient un pouvoir de nuire sans limite. Dans La Tempête de Shakespeare (1611), il est dit de l’esclave Caliban que sa mère « était une puissante sorcière », et François Guizot précisait à ce sujet dans sa traduction de 1864 : « Dans toutes les anciennes accusations de sorcellerie en Angleterre, on trouve constamment l’épithète strong (“forte”, “puissante”) associée au mot witch (“sorcière”), comme une qualification spéciale et augmentative. Les tribunaux furent obligés de décider, contre l’opinion populaire, que le mot strong n’ajoutait rien à l’accusation. »
Avoir un corps de femme pouvait suffire à faire de vous une suspecte. Après leur arrestation, les accusées étaient dénudées, rasées et livrées à un « piqueur », qui recherchait minutieusement la marque du Diable, à la surface comme à l’intérieur de leur corps, en y enfonçant des aiguilles. N’importe quelle tache, cicatrice ou irrégularité pouvait faire office de preuve et on comprend que les femmes âgées aient été confondues en masse. Cette marque était censée rester insensible à la douleur ; or beaucoup de prisonnières étaient si choquées par ce viol de leur pudeur – par ce viol tout court – qu’elles s’évanouissaient à moitié et ne réagissaient donc pas aux piqûres. En Écosse, des « piqueurs » passaient même dans les villages et les villes en proposant de démasquer les sorcières qui se dissimulaient parmi leurs habitantes. En 1649, la ville anglaise de Newcastle-upon-Tyne engagea l’un d’eux en lui promettant vingt shillings par condamnée. Trente femmes furent amenées à la mairie et déshabillées. La plupart – quelle surprise – furent déclarées coupables16.
« Comme lorsque je lis le journal, j’en ai appris davantage que je ne l’aurais souhaité sur la cruauté humaine », avoue Anne L. Barstow dans l’introduction à son étude des chasses aux sorcières européennes17. Et, en effet, le récit des tortures est insoutenable : le corps désarticulé par l’estrapade, brûlé par des sièges en métal chauffé à blanc, les os des jambes brisés par les brodequins. Les démonologues recommandent de ne pas se laisser émouvoir par les larmes, attribuées à une ruse diabolique et forcément feintes. Les chasseurs de sorcières se montrent à la fois obsédés et terrifiés par la sexualité féminine. Les interrogateurs demandent inlassablement aux accusées « comment était le pénis du Diable ». Le Marteau des sorcières affirme qu’elles ont le pouvoir de faire disparaître les sexes masculins et qu’elles en conservent des collections entières dans des boîtes ou dans des nids d’oiseau où ils frétillent désespérément (on n’en a cependant jamais retrouvé). Par sa forme phallique, le balai qu’elles chevauchent, en plus d’être un symbole ménager détourné, témoigne de leur liberté sexuelle. Le sabbat est vu comme le lieu d’une sexualité débridée, hors de contrôle. Les tortionnaires jouissent de la domination absolue qu’ils exercent sur les prisonnières ; ils peuvent donner libre cours à leur voyeurisme et leur sadisme sexuel. S’y ajoutent les viols par les gardiens : lorsqu’une détenue est retrouvée étranglée dans son cachot, on dit que le Diable est venu reprendre sa servante. Beaucoup de condamnées, au moment de leur exécution, ne peuvent même plus tenir debout. Mais, même si elles sont soulagées d’en finir, il leur reste à affronter une mort atroce. Le démonologue Henry Boguet relate la fin de Clauda Jam-Guillaume, qui trouve par trois fois la force de s’échapper du bûcher. Le bourreau n’avait pas respecté sa promesse de l’étrangler avant que les flammes ne l’atteignent. Elle l’oblige ainsi à tenir parole : la troisième fois, il l’assomme, de sorte qu’elle meurt inconsciente18.

De tout cela, il paraît difficile de ne pas déduire que les chasses aux sorcières ont été une guerre contre les femmes. Et pourtant… Spécialiste des procès en sorcellerie en Nouvelle-Angleterre, Carol F. Karlsen déplore que son « approche en termes de genre ait été ignorée, banalisée ou indirectement contestée » dans les nombreuses publications, savantes ou généralistes, auxquelles a donné lieu, en 1992, le 300e anniversaire de l’affaire des sorcières de Salem19. Anne L. Barstow juge « aussi extraordinaire que ces événements eux-mêmes » l’obstination mise par les historiens à nier que les chasses aux sorcières furent une « explosion de misogynie »20. Elle cite les étonnantes contorsions auxquelles doivent parfois se livrer ses confrères – ou ses consœurs – pour contredire les conclusions qui se dégagent de leurs propres recherches. Guy Bechtel en offre d’ailleurs lui-même une illustration quand, après avoir détaillé la « diabolisation de la femme » qui précéda les chasses aux sorcières, il interroge : « Est-ce à dire que l’antiféminisme explique les bûchers ? » et répond, péremptoire : « Certainement pas. » Il invoque à l’appui de cette conclusion des arguments plutôt faibles : d’abord, « on brûla aussi des hommes » et, ensuite, « l’antiféminisme – qui se développa à la fin du XIIIe siècle – précède d’assez loin le temps des bûchers ». Or, si certains hommes ont été perdus par les dénonciations de femmes « possédées », comme dans les affaires célèbres de Loudun et de Louviers, la plupart n’étaient accusés de sorcellerie, on l’a dit, que par association avec des femmes, ou alors de façon secondaire, ce crime s’ajoutant à d’autres chefs d’accusation. Quant au fait que l’antiféminisme venait de loin, on pourrait y voir au contraire une confirmation du rôle décisif qu’il joua ici. Des siècles de haine et d’obscurantisme semblent avoir culminé dans ce déchaînement de violence, né d’une peur devant la place grandissante que les femmes occupaient alors dans l’espace social21.
Jean Delumeau voit dans le De planctu ecclesiae d’Alvaro Pelayo, rédigé vers 1330 à la demande de Jean XXII, le « document majeur de l’hostilité cléricale à la femme », un « appel à la guerre sainte contre l’alliée du Diable » et le précurseur du Malleus maleficarum. Le franciscain espagnol y affirme notamment que les femmes, « sous un extérieur d’humilité, cachent un tempérament orgueilleux et incorrigible, en quoi elles ressemblent aux Juifs »22. Dès la fin du Moyen Âge, affirme Bechtel, « même les ouvrages les plus laïcs sont empreints de misogynie23 ». En la matière, les pères de l’Église et leurs successeurs prolongeaient d’ailleurs les traditions grecque et romaine. Avant qu’Ève mange le fruit défendu, Pandore, dans la mythologie grecque, avait ouvert l’urne contenant tous les maux de l’humanité. Le christianisme naissant emprunta beaucoup au stoïcisme, déjà ennemi des plaisirs et donc des femmes. « Aucun groupe au monde ne fut jamais si longtemps et si durement insulté », estime Bechtel. À lire cette littérature, on se dit que cette rhétorique devait inévitablement produire un jour ou l’autre une forme de passage à l’acte à grande échelle. En 1593, un pasteur allemand un peu plus pacifique que les autres s’alarme de ces « petites brochures qui colportent en tous lieux l’injure contre les femmes » et dont la lecture « sert de passe-temps aux oisifs » ; « et l’homme du peuple, à force d’entendre et de lire ces choses, est exaspéré contre les femmes, et quand il apprend que l’une d’elles est condamnée à périr sur le bûcher, il s’écrie : “C’est bien fait !” ».
« Hystériques », « pauvres femmes » : Anne L. Barstow souligne également la condescendance dont font preuve beaucoup d’historiens à l’égard des victimes des chasses aux sorcières. Colette Arnould trouve la même attitude chez Voltaire, qui écrivait à propos de la sorcellerie : « Seule l’action de la philosophie a guéri de cette abominable chimère et a appris aux hommes qu’il ne faut pas brûler les imbéciles. » Or, objecte-t-elle, « les imbéciles avaient d’abord été les juges, et ils avaient si bien fait que cette imbécillité-là était devenue contagieuse »24. On retrouve aussi le réflexe de blâmer les victimes : étudiant les chasses dans le sud de l’Allemagne, l’éminent professeur américain Erik Midelfort observe que les femmes « semblaient provoquer une intense misogynie à l’époque » et préconise d’étudier « pourquoi ce groupe se plaçait en situation de bouc émissaire »25. Carol F. Karlsen conteste le portrait souvent dressé des accusées en Nouvelle-Angleterre, qui, en évoquant leur « mauvais caractère » ou leur « personnalité déviante », épouse le point de vue des accusateurs : elle y voit une manifestation de la « tendance profondément enracinée dans notre société à rendre les femmes responsables de la violence qui leur est infligée »26. Peut-être ce mépris et ces préjugés signifient-ils simplement que, même s’ils ne les approuvent pas, même s’ils en perçoivent l’horreur, ceux qui prennent les chasses aux sorcières pour objet d’étude historique restent malgré tout, comme l’était Voltaire, des produits du monde qui a chassé les sorcières. Peut-être faut-il en déduire que le travail nécessaire pour exposer la façon dont cet épisode a transformé les sociétés européennes n’en est encore qu’à ses balbutiements.
Son bilan en vies humaines reste très discuté et ne sera probablement jamais établi avec certitude. Dans les années 1970, on évoquait un million de victimes, voire bien plus. Aujourd’hui, on parle plutôt de cinquante ou cent mille27. N’y sont pas incluses celles qui ont été lynchées, ni celles qui se sont suicidées ou qui sont mortes en prison – soit des suites de la torture, soit en raison de leurs conditions de détention sordides. D’autres, sans perdre la vie, ont été bannies, ou ont vu leur réputation et celle de leur famille ruinées. Mais toutes les femmes, même celles qui n’ont jamais été accusées, ont subi les effets de la chasse aux sorcières. La mise en scène publique des supplices, puissant instrument de terreur et de discipline collective, leur intimait de se montrer discrètes, dociles, soumises, de ne pas faire de vagues. En outre, elles ont dû acquérir d’une manière ou d’une autre la conviction qu’elles incarnaient le mal ; elles ont dû se persuader de leur culpabilité et de leur noirceur fondamentales.
C’en était fini de la sous-culture féminine vivace et solidaire du Moyen Âge, constate Anne L. Barstow. Pour elle, la montée de l’individualisme – au sens d’un repli sur soi et d’une focalisation sur ses seuls intérêts – au cours de la période qui suit doit être, dans le cas des femmes, largement attribuée à la peur28. Il y avait de quoi se sentir incitée à faire profil bas, comme en témoignent certaines affaires. En 1679, à Marchiennes, Péronne Goguillon échappe de peu à une tentative de viol par quatre soldats ivres qui, pour la laisser tranquille, lui extorquent la promesse de leur verser de l’argent. En les dénonçant, son mari attire l’attention sur la mauvaise réputation antérieure de sa femme : elle est brûlée comme sorcière29. De même, dans le cas d’Anna Göldi, son biographe, le journaliste suisse Walter Hauser, a retrouvé la trace d’une plainte pour harcèlement sexuel qu’elle avait déposée contre le médecin qui l’employait comme domestique. Celui-ci l’avait alors accusée de sorcellerie pour allumer un contre-feu30.

En s’emparant de l’histoire des femmes accusées de sorcellerie, les féministes occidentales ont à la fois perpétué leur subversion – qu’elle ait été délibérée ou pas – et revendiqué, par défi, la puissance terrifiante que leur prêtaient les juges. « Nous sommes les petites-filles des sorcières que vous n’avez pas réussi à brûler », dit un slogan célèbre ; ou, en Italie, dans les années 1970 : « Tremblez, tremblez, les sorcières sont revenues ! » ( Tremate, tremate, le streghe son tornate !). Elles ont aussi réclamé justice, en luttant contre le traitement léger et édulcoré de cette histoire. En 1985, la ville allemande de Gelnhausen a transformé en attraction touristique sa « Tour aux sorcières », la bâtisse où les accusées de sorcellerie avaient autrefois été emmurées vivantes. Le matin de l’ouverture au public, des manifestantes vêtues de blanc ont défilé autour de l’édifice en arborant des panneaux où figuraient les noms des victimes31. Ces efforts de sensibilisation, d’où qu’ils viennent, ont parfois payé : en 2008, le canton de Glaris a officiellement réhabilité Anna Göldi, grâce à l’obstination de son biographe, et lui a consacré un musée32. Fribourg, Cologne et Nieuport, en Belgique, ont suivi. La Norvège a inauguré en 2013 le mémorial de Steilneset, fruit d’une collaboration entre l’architecte Peter Zumthor et l’artiste Louise Bourgeois, qui rend hommage, à l’endroit même où elles furent brûlées, aux quatre-vingt-onze personnes exécutées dans le comté septentrional de Finnmark33.
La première féministe à exhumer l’histoire des sorcières et à revendiquer elle-même ce titre a été l’Américaine Matilda Joslyn Gage (1826-1898), qui militait pour le droit de vote des femmes, mais aussi pour les droits des Amérindiens et l’abolition de l’esclavage – elle fut condamnée pour avoir aidé des esclaves à s’enfuir. Dans Femme, Église et État, en 1893, elle livra une lecture féministe des chasses aux sorcières : « Quand, au lieu de “sorcières”, on choisit de lire “femmes”, on gagne une meilleure compréhension des cruautés infligées par l’Église à cette portion de l’humanité34. » Elle a inspiré le personnage de Glinda dans Le Magicien d’Oz, écrit par Lyman Frank Baum, dont elle était la belle-mère. En adaptant ce roman au cinéma, en 1939, Victor Fleming a donné naissance à la première « bonne sorcière » de la culture populaire35.
Puis, en 1968, le jour de Halloween, à New York, surgit le mouvement Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH), dont les membres défilèrent dans Wall Street et dansèrent la sarabande, main dans la main, vêtus de capes noires, devant la Bourse. « Les yeux fermés, la tête baissée, les femmes entonnèrent un chant berbère (sacré aux yeux des sorcières algériennes) et proclamèrent l’effondrement imminent de diverses actions. Quelques heures plus tard, le marché clôtura en baisse d’un point et demi, et le lendemain, il chuta de cinq points », racontait quelques années plus tard l’une d’entre elles, Robin Morgan36. Elle soulignait toutefois leur ignorance totale, à l’époque, de l’histoire des sorcières : « À la Bourse, nous avons demandé une entrevue avec Satan, notre supérieur – un faux pas qui, avec le recul, me consterne : c’est l’Église catholique qui a inventé Satan et qui a ensuite accusé les sorcières d’être satanistes. Nous avons mordu à l’hameçon patriarcal sur ce sujet, et sur tant d’autres. Nous étions complètement stupides. Mais nous étions stupides avec du style37. » C’est vrai : les photos de l’événement en témoignent. En France, le féminisme de la deuxième vague a notamment vu la création de la revue Sorcières, publiée à Paris entre 1976 et 1981 sous la direction de Xavière Gauthier et à laquelle collaborèrent Hélène Cixous, Marguerite Duras, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Nancy Huston ou encore Annie Leclerc38. Il faut aussi mentionner la très belle chanson d’Anne Sylvestre, qui, en plus de ses comptines pour enfants, est l’autrice d’un important répertoire féministe : Une sorcière comme les autres, écrite en 197539.
En 1979 paraissait aux États-Unis The Spiral Dance, le premier livre de Starhawk. Il allait devenir un ouvrage de référence sur le culte néopaïen de la déesse. Le nom de la sorcière californienne – née Miriam Simos en 1951 – n’arriva cependant aux oreilles européennes qu’en 1999, lors de la participation remarquée de Starhawk et de ses amis aux manifestations contre la réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle, qui marquèrent la naissance de l’altermondialisme. En 2003, l’éditeur Philippe Pignarre et la philosophe Isabelle Stengers publiaient la première traduction française d’un de ses livres : Femmes, magie et politique, qui date de 198240. En signalant sur une liste de discussion l’article que je lui avais consacré, je me rappelle avoir déchaîné les sarcasmes furieux d’un autre abonné, un auteur de romans policiers qui n’avait pas eu de mots assez durs pour me dire l’accablement dans lequel le plongeait la notion de « sorcellerie néopaïenne ». Une quinzaine d’années plus tard, son opinion n’a pas forcément changé, mais la référence a beaucoup perdu de son incongruité. Aujourd’hui, les sorcières sont partout. Aux États-Unis, elles prennent part au mouvement Black Lives Matter (« Les vies des Noirs comptent », contre les meurtres racistes commis par la police), jettent des sorts à Donald Trump, protestent contre les suprémacistes blancs ou contre la remise en question du droit à l’avortement. À Portland (Oregon) et ailleurs, des groupes ressuscitent WITCH. En France, en 2015, Isabelle Cambourakis a baptisé « Sorcières » la collection féministe qu’elle a créée au sein de la maison d’édition familiale. Elle a commencé par y republier Femmes, magie et politique, qui a rencontré beaucoup plus d’écho que la première fois41 – d’autant plus que venait de paraître la traduction française de Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Et lors des manifestations de septembre 2017 contre la casse du code du travail est apparu, à Paris et à Toulouse, un Witch Bloc féministe et anarchiste qui a défilé avec des chapeaux pointus et une banderole « Macron au chaudron ».
Les misogynes se montrent eux aussi, comme autrefois, obsédés par la figure de la sorcière. « Le féminisme encourage les femmes à quitter leurs maris, à tuer leurs enfants, à pratiquer la sorcellerie, à détruire le capitalisme et à devenir lesbiennes », tonnait déjà en 1992 le télévangéliste américain Pat Robertson dans une tirade restée célèbre (suscitant chez beaucoup cette réaction : « Où est-ce qu’on s’inscrit ? »). Durant la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, la haine manifestée à l’égard de Hillary Clinton a dépassé de très loin les critiques, même les plus virulentes, que l’on pouvait légitimement lui adresser. La candidate démocrate a été associée au « Mal » et abondamment comparée à une sorcière, c’est-à-dire attaquée en tant que femme, et non en tant que dirigeante politique. Après sa défaite, certains ont exhumé sur YouTube la chanson qui salue la mort de la Méchante Sorcière de l’Est dans Le Magicien d’Oz : Ding Dong, the Witch Is Dead (« Ding dong, la sorcière est morte ») – une ritournelle qui avait déjà resurgi lors de la disparition de Margaret Thatcher en 2013. Cette référence a été brandie non seulement par les électeurs de Donald Trump, mais aussi par certains partisans du rival de Hillary Clinton à la primaire. Sur le site officiel de Bernie Sanders, l’un d’eux a annoncé une collecte de fonds sous l’intitulé Bern the Witch (un jeu de mots avec Burn the Witch, « Brûlez la sorcière », avec « Bern » comme « Bernie » au lieu de burn) ; une annonce que l’équipe de campagne du sénateur du Vermont a retirée dès qu’elle lui a été signalée42. Dans la série des plaisanteries pénibles, l’éditorialiste conservateur Rush Limbaugh a assené : She’s a witch with a capital B (« C’est une sorcière avec un P majuscule ») – il ignorait sans doute qu’au XVIIe siècle un protagoniste de l’affaire de Salem, dans le Massachusetts, avait déjà exploité cette consonance en traitant l’une des accusatrices, sa servante Sarah Churchill, de bitch witch (« pute sorcière »)43. En réaction sont apparus chez les électrices démocrates des badges « Les sorcières pour Hillary » ou « Les harpies pour Hillary »44.
Un tournant notable s’est produit ces dernières années dans la façon dont les féministes françaises appréhendent la figure de la sorcière. Dans leur présentation de Femmes, magie et politique, en 2003, les éditeurs écrivaient : « En France, ceux qui font de la politique ont pris l’habitude de se méfier de tout ce qui relève de la spiritualité, qu’ils ont vite fait de taxer d’être d’extrême droite. Magie et politique ne font pas bon ménage et si des femmes décident de s’appeler sorcières, c’est en se débarrassant de ce qu’elles considèrent comme des superstitions et de vieilles croyances, en ne retenant que la persécution dont elles furent victimes de la part des pouvoirs patriarcaux. » Ce constat n’est plus aussi vrai aujourd’hui. En France comme aux États-Unis, de jeunes féministes, mais aussi des hommes gays et des trans, revendiquent tranquillement le recours à la magie. Entre l’été 2017 et le printemps 2018, la journaliste et autrice Jack Parker a édité Witch, Please, la « newsletter des sorcières modernes », qui comptait plusieurs milliers d’abonnés. Elle y diffusait des photos de son autel et de ses grimoires personnels, des interviews d’autres sorcières, ainsi que des conseils de rituels en lien avec la position des astres et les phases de la lune.
Ces nouvelles adeptes ne suivent aucune liturgie commune : « La sorcellerie étant une pratique, elle n’a pas besoin d’être accompagnée d’un culte religieux, mais peut parfaitement se combiner à lui, explique Mæl, une sorcière française. Il n’y a pas ici d’incompatibilité fondamentale. On trouve ainsi des sorcières des grandes religions monothéistes (chrétiennes, musulmanes, juives), des sorcières athées, des sorcières agnostiques, mais aussi des sorcières des religions païennes et néopaïennes (polythéistes, wiccanes, hellénistes, etc.)45. » Starhawk – qui s’inscrit pour sa part dans le cadre très vaste de la Wicca, la religion néopaïenne – prône elle aussi l’invention de rituels en fonction des besoins. Elle raconte par exemple comment est né celui par lequel elle et ses amies fêtent le solstice d’hiver, en allumant un grand feu sur la plage puis en plongeant dans les vagues de l’océan, bras levés, avec des chants et des vociférations de jubilation : « Au cours d’un des premiers solstices que nous avons célébrés, nous sommes allées sur la plage regarder le soleil se coucher avant notre rituel du soir. Une femme a dit : “Enlevons nos vêtements et sautons dans l’eau ! Allez, chiche !” Je me rappelle lui avoir répondu : “Tu es folle”, mais nous l’avons fait quand même. Après quelques années, nous avons eu l’idée d’allumer un feu, histoire de conjurer l’hypothermie, et ainsi une tradition est née. (Faites quelque chose une fois, c’est une expérience. Faites-le deux fois, c’est une tradition.)46 »

Comment expliquer cette vogue inédite ? Celles et ceux qui pratiquent la sorcellerie ont grandi avec Harry Potter, mais aussi avec les séries Charmed – dont les héroïnes sont trois sœurs sorcières – et Buffy contre les vampires – où Willow, d’abord lycéenne timide et effacée, devient une puissante sorcière –, ce qui peut avoir joué un rôle. La magie apparaît paradoxalement comme un recours très pragmatique, un sursaut vital, une manière de s’ancrer dans le monde et dans sa vie à une époque où tout semble se liguer pour vous précariser et vous affaiblir. Dans sa newsletter du 16 juillet 2017, Jack Parker refusait de trancher la question « effet placebo ou vraie magie ancestrale » : « L’important, c’est que ça marche et que ça nous fasse du bien, non ? […] On est toujours en train de chercher le sens de la vie, celui de notre existence, et pourquoi et comment et où vais-je et que suis-je et que vais-je devenir, alors si on peut s’accrocher à deux-trois trucs qui nous rassurent et qu’on a l’impression de maîtriser en cours de route, pourquoi cracher dans la soupe ? » Sans avoir de pratique de la magie au sens littéral, je retrouve là quelque chose que j’ai défendu en plaidant, ailleurs47, pour le temps à soi, le retrait régulier du monde, l’abandon confiant aux pouvoirs de l’imaginaire et de la rêverie. Avec son insistance sur la pensée positive et ses invitations à « découvrir sa déesse intérieure », la vogue de la sorcellerie forme aussi un sous-genre à part entière dans le vaste filon du développement personnel. Une mince ligne de crête sépare ce développement personnel – fortement mêlé de spiritualité – du féminisme et de l’ empowerment politique, qui impliquent la critique des systèmes d’oppression ; mais, sur cette ligne de crête, il se passe des choses tout à fait dignes d’intérêt.
Peut-être aussi la catastrophe écologique, de plus en plus visible, a-t-elle diminué le prestige et le pouvoir d’intimidation de la société technicienne, levant les inhibitions à s’affirmer sorcière. Quand un système d’appréhension du monde qui se présente comme suprêmement rationnel aboutit à détruire le milieu vital de l’humanité, on peut être amené à remettre en question ce qu’on avait pris l’habitude de ranger dans les catégories du rationnel et de l’irrationnel. De fait, la vision mécaniste du monde témoigne d’une conception de la science désormais caduque. Les découvertes les plus récentes, au lieu de les renvoyer dans le domaine du farfelu ou du charlatanisme, convergent avec les intuitions des sorcières. « La physique moderne, écrit Starhawk, ne parle plus des atomes séparés et isolés d’une matière morte, mais de vagues de flux d’énergies, de probabilités, de phénomènes qui changent quand on les observe ; elle reconnaît ce que les chamans et les sorcières ont toujours su : que l’énergie et la matière ne sont pas des forces séparées mais des formes différentes de la même chose48. » On assiste, comme alors, à un renforcement de tous les types de domination, symbolisé par l’élection à la tête du pays le plus puissant du monde d’un milliardaire professant une misogynie et un racisme décomplexés ; de sorte que la magie apparaît à nouveau comme l’arme des opprimés. La sorcière surgit au crépuscule, alors que tout semble perdu. Elle est celle qui parvient à trouver des réserves d’espoir au cœur du désespoir. « Lorsque nous entamerons une nouvelle trajectoire, tous les pouvoirs de la vie, de la fertilité et de la régénération abonderont autour de nous. Et lorsque nous nous allierons à ces pouvoirs, des miracles pourront arriver », écrivait Starhawk en 2005, dans un récit des jours qu’elle a passés à La Nouvelle-Orléans pour prêter main-forte aux rescapés de l’ouragan Katrina49.
L’affrontement entre les défenseurs des droits des femmes ou des minorités sexuelles et les tenants d’idéologies réactionnaires s’exacerbe. Le 6 septembre 2017, à Louisville, dans le Kentucky, le groupe WITCH local manifestait pour défendre le dernier centre d’IVG de l’État, menacé de fermeture, en clamant : « Les fanatiques religieux américains crucifient les droits des femmes depuis 160050. » Il en résulte un esprit du temps fait d’un curieux mélange de sophistication technologique et d’archaïsme oppressif, qu’a bien saisi la série The Handmaid’s Tale ( La Servante écarlate), adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood. Ainsi, en février 2017, un groupe de sorcières – auxquelles s’est jointe la chanteuse Lana Del Rey – se donnait rendez-vous au pied de la Trump Tower à New York afin de provoquer la destitution du président. Les organisateurs demandaient de se procurer « un fil noir, du soufre, des plumes, du sel, une bougie orange ou blanche ou encore une photo “désavantageuse” de Donald Trump ». En réaction, les chrétiens nationalistes ont invité à contrer cette offensive spirituelle en récitant un psaume de David. Ils ont fait passer le mot sur Twitter avec le hashtag #PrayerResistance51. Oui, drôle d’ambiance…
Dans un rapport (assez déjanté) publié en août 2015, le bureau de style new-yorkais K-Hole annonçait avoir identifié une nouvelle tendance culturelle : la « magie du chaos ». Il ne s’était pas trompé. L’autrice d’une enquête consacrée au million d’Américains adeptes d’un culte païen52 parue cette année-là témoignait : « Quand j’ai commencé à travailler sur ce livre, les gens à qui j’en parlais me regardaient d’un œil vide. Au moment de sa sortie, on m’a accusée de surfer sur la tendance53 ! » Pratique spirituelle et/ou politique, la sorcellerie est aussi une esthétique, une mode… et un filon commercial. Elle a ses hashtags sur Instagram et ses rayons virtuels sur Etsy, ses influenceuses et ses autoentrepreneuses, qui vendent en ligne sorts, bougies, grimoires, superaliments, huiles essentielles et cristaux. Elle inspire les couturiers ; les marques s’en emparent. Rien d’étonnant à cela : après tout, le capitalisme passe son temps à nous revendre sous la forme de produits ce qu’il a commencé par détruire. Mais il y a peut-être aussi une affinité naturelle à l’œuvre ici. Jean Baudrillard a mis en lumière en 1970 à quel point l’idéologie de la consommation est imprégnée de pensée magique, parlant d’une « mentalité miraculeuse54 ». Dans son rapport, K-Hole établit un parallèle entre la logique de la magie et celle d’une stratégie de marque : « Toutes deux sont affaire de création. Mais, alors que la promotion d’une marque implique d’implanter des idées dans le cerveau du public, la magie consiste à les implanter dans le vôtre. » La magie a « ses symboles et ses mantras » ; les marques ont « leurs logos et leurs slogans »55.
Avant même que la sorcellerie ne devienne un concept rentable, on peut penser que l’industrie cosmétique, en particulier, a bâti une partie de sa prospérité sur une obscure nostalgie de la magie présente chez beaucoup de femmes, en leur vendant ses pots et ses fioles, ses actifs miraculeux, ses promesses de transformation, son immersion dans un univers enchanté. C’est flagrant avec la marque française Garancia, dont les produits s’appellent « Huile ensorcelante aux super pouvoirs », « Pschitt magique », « Eau de sourcellerie », « Diabolique Tomate », « Bal masqué des sorciers » ou « Que mes rougeurs disparaissent ! ». Mais aussi avec la marque de produits naturels de luxe Susanne Kaufmann : sa créatrice est « une Autrichienne qui a grandi dans la forêt de Bregenz. Enfant, sa grand-mère lui transmet sa passion des plantes avec lesquelles elle élabore des remèdes56 ». De même, le mot anglais glamour (comme le mot français « charme ») a perdu son ancien sens de « sortilège » pour signifier simplement « beauté », « éclat » ; il est associé au show-biz et au magazine féminin qui porte son nom. « Le patriarcat nous a volé notre cosmos et nous l’a rendu sous la forme du magazine Cosmopolitan et des cosmétiques », résume Mary Daly57.
La « routine quotidienne » ( daily routine) de beauté, rubrique des magazines féminins où une femme en vue expose la façon dont elle prend soin de sa peau et, plus globalement, de sa forme et de sa santé, suscite une fascination largement partagée (y compris par moi). Des chaînes YouTube et des sites Internet (le plus célèbre étant l’Américain Into The Gloss) lui sont consacrés, et on la retrouve y compris dans des médias féministes. Les lignes de cosmétiques constituent une jungle dans laquelle il faut beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour se retrouver, et ces rubriques contribuent à y immerger les consommatrices, à entretenir leur obsession pour les marques et les produits. Impliquant de cultiver une expertise particulière, des secrets transmis entre femmes (il y est souvent fait référence à ce que l’interviewée a appris de sa mère), une science des principes actifs et des protocoles, une discipline, mais donnant aussi un sentiment d’ordre, de maîtrise et de plaisir dans un quotidien parfois chaotique, la daily routine pourrait bien apparaître comme une forme dégradée de l’initiation des sorcières. On parle d’ailleurs de « rituels » de beauté et celles qui les maîtrisent le mieux sont qualifiées de « prêtresses ».
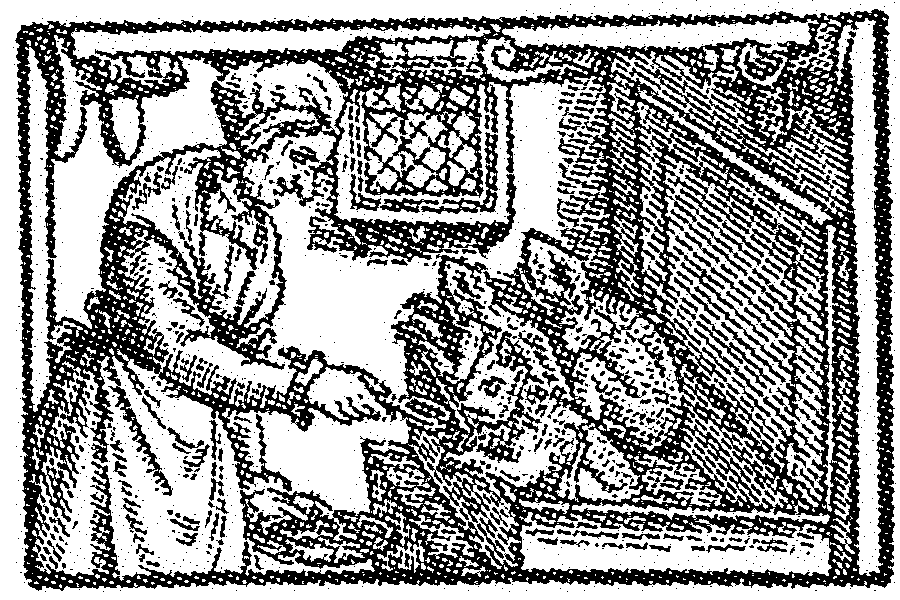
Les pages qui suivent ne parleront toutefois que très peu de la sorcellerie contemporaine, du moins dans son sens littéral. Ce qui m’intéresse, au vu de l’histoire que j’ai retracée ici dans ses grandes lignes, c’est plutôt d’explorer la postérité des chasses aux sorcières en Europe et aux États-Unis. Celles-ci ont à la fois traduit et amplifié les préjugés à l’égard des femmes, l’opprobre qui frappait certaines d’entre elles. Elles ont réprimé certains comportements, certaines manières d’être. Nous avons hérité de ces représentations forgées et perpétuées au fil des siècles. Ces images négatives continuent à produire, au mieux, de la censure ou de l’autocensure, des empêchements ; au pire, de l’hostilité, voire de la violence. Et, quand bien même il existerait une volonté sincère et largement partagée de leur faire subir un examen critique, nous n’avons pas de passé de rechange. Comme l’écrit Françoise d’Eaubonne, « les contemporains sont façonnés par des événements qu’ils peuvent ignorer et dont la mémoire même se sera perdue ; mais rien ne peut empêcher qu’ils seraient différents, et penseraient peut-être d’autre façon, si ces événements n’avaient pas eu lieu58 ».
Le champ est immense, mais j’aimerais me concentrer sur quatre aspects de cette histoire. Il y a d’abord le coup porté à toutes les velléités d’indépendance féminine (chapitre 1). Parmi les accusées de sorcellerie, on relève une surreprésentation des célibataires et des veuves, c’est-à-dire de toutes celles qui n’étaient pas subordonnées à un homme59. À cette époque, les femmes sont évincées de la place qu’elles occupaient dans le monde du travail. On les expulse des corporations ; l’apprentissage des métiers se formalise et on leur en interdit l’accès. La femme seule, en particulier, subit une « pression économique insoutenable60 ». En Allemagne, les veuves de maîtres artisans ne sont plus autorisées à poursuivre l’œuvre de leur mari. Quant aux femmes mariées, la réintroduction du droit romain en Europe à partir du XIe siècle a consacré leur incapacité juridique, tout en leur laissant une marge d’autonomie qui, au XVIe siècle, se referme. Jean Bodin, dont on choisit pudiquement d’oublier le joyeux passe-temps de démonologue, est resté célèbre pour sa théorie de l’État ( Les Six Livres de la République). Or, fait remarquer Armelle Le Bras-Chopard, il se distingue par une vision où le bon gouvernement de la famille et celui de l’État, tous deux assurés par une autorité masculine, se renforcent mutuellement ; ce qui n’est peut-être pas sans lien avec son obsession des sorcières. L’incapacité sociale de la femme mariée sera consacrée en France par le code civil de 1804. Les chasses auront rempli leur office : plus besoin de brûler de prétendues sorcières, dès lors que la loi « permet de brider l’autonomie de toutes les femmes61 »… Aujourd’hui, l’indépendance des femmes, même quand elle est possible juridiquement et matériellement, continue de susciter un scepticisme général. Leur lien avec un homme et des enfants, vécu sur le mode du don de soi, reste considéré comme le cœur de leur identité. La façon dont les filles sont élevées et socialisées leur apprend à redouter la solitude et laisse leurs facultés d’autonomie largement en friche. Derrière la figure fameuse de la « célibataire à chat », laissée-pour-compte censée être un objet de pitié et de dérision, on distingue l’ombre de la redoutable sorcière d’autrefois, flanquée de son « familier » diabolique.
Dans le même temps, l’époque des chasses aux sorcières a vu la criminalisation de la contraception et de l’avortement. En France, une loi promulguée en 1556 oblige toute femme enceinte à déclarer sa grossesse et à disposer d’un témoin lors de l’accouchement. L’infanticide y devient un crimen exceptum – ce que n’est même pas la sorcellerie62. Parmi les accusations portées contre les « sorcières » figurait souvent celle d’avoir fait mourir des enfants ; du sabbat, on disait qu’on y dévorait des cadavres d’enfants. La sorcière est l’« antimère63 ». Beaucoup d’accusées étaient des guérisseuses qui jouaient le rôle de sage-femme, mais qui aidaient aussi les femmes désireuses d’empêcher ou d’interrompre une grossesse. Pour Silvia Federici, les chasses aux sorcières ont permis de préparer la division sexuée du travail requise par le capitalisme, en réservant le travail rémunéré aux hommes et en assignant les femmes à la mise au monde et à l’éducation de la future main-d’œuvre64. Cette assignation dure jusqu’à aujourd’hui : les femmes sont libres d’avoir des enfants ou pas… à condition de choisir d’en avoir. Celles qui n’en souhaitent pas sont parfois assimilées à des créatures sans cœur, obscurément mauvaises, malveillantes à l’égard de ceux des autres (chapitre 2).
Les chasses aux sorcières ont aussi inscrit profondément dans les consciences une image très négative de la vieille femme (chapitre 3). Certes, on a brûlé de toutes jeunes « sorcières », et même des enfants de sept ou huit ans, filles et garçons ; mais les plus âgées, jugées à la fois répugnantes par leur aspect et particulièrement dangereuses du fait de leur expérience, ont été les « victimes favorites des chasses65 ». « Au lieu de recevoir les soins et la tendresse dus aux femmes âgées, celles-ci ont été si souvent accusées de sorcellerie que, pendant des années, il fut inhabituel que l’une d’elles, dans le Nord de l’Europe, meure dans son lit », écrivait Matilda Joslyn Gage66. L’obsession haineuse des peintres (Quentin Metsys, Hans Baldung, Niklaus Manuel Deutsch) et des poètes (Ronsard, Du Bellay)67 pour la vieille femme s’explique par le culte de la jeunesse qui se développe à l’époque et par le fait que les femmes vivent désormais plus longtemps. En outre, la privatisation de terres autrefois partagées – ce qu’on a appelé en Angleterre les « enclosures » – au cours de l’accumulation primitive qui a préparé l’avènement du capitalisme a particulièrement pénalisé les femmes. Les hommes accédaient plus facilement au travail rémunéré, devenu le seul moyen de subsister. Elles dépendaient plus qu’eux des communaux, ces terres où il était possible de faire paître des vaches, de ramasser du bois ou des herbes68. Ce processus a, à la fois, sapé leur indépendance et réduit les plus vieilles à la mendicité quand elles ne pouvaient pas compter sur le soutien de leurs enfants. Bouche désormais inutile à nourrir, la femme ménopausée, au comportement et à la parole parfois plus libres qu’auparavant, est devenue un fléau dont il fallait se débarrasser. On la croyait aussi animée par un désir sexuel encore plus dévorant que dans sa jeunesse – ce qui la poussait à rechercher la copulation avec le Diable ; ce désir apparaissait comme grotesque et suscitait la répulsion. On peut présumer que si, aujourd’hui, les femmes sont réputées se flétrir avec le temps alors que les hommes se bonifient, si l’âge les pénalise sur le plan amoureux et conjugal, si la course à la jeunesse prend pour elles un tour aussi désespéré, c’est largement en raison de ces représentations qui continuent de hanter notre imaginaire, des sorcières de Goya à celles de Walt Disney. La vieillesse des femmes reste, d’une manière ou d’une autre, laide, honteuse, menaçante, diabolique.
L’asservissement des femmes nécessaire à la mise en place du système capitaliste est allé de pair avec celui des peuples déclarés « inférieurs », esclaves et colonisés, pourvoyeurs de ressources et de main-d’œuvre gratuites – c’est la thèse de Silvia Federici69. Mais il s’est aussi accompagné d’une mise en coupe réglée de la nature, et de l’instauration d’une nouvelle conception du savoir. Il en a découlé une science arrogante, nourrie de mépris à l’égard du féminin, associé à l’irrationnel, au sentimental, à l’hystérie, à une nature qu’il s’agissait de dominer (chapitre 4). La médecine moderne, en particulier, s’est construite sur ce modèle et en lien direct avec les chasses aux sorcières, qui ont permis aux médecins officiels de l’époque d’éliminer la concurrence des guérisseuses – en général bien plus compétentes qu’eux. Elle a hérité d’un rapport structurellement agressif au patient, et plus encore à la patiente, comme en témoignent les maltraitances et les violences de plus en plus souvent dénoncées depuis quelques années, en particulier grâce aux réseaux sociaux. Notre glorification d’une « raison » souvent pas si rationnelle que cela, et notre rapport belliqueux à la nature, auquel nous sommes si habitués que nous ne le voyons même plus, ont de tout temps subi des remises en question – qui deviennent aujourd’hui plus urgentes que jamais. Ces remises en question se font parfois hors de toute logique de genre, mais parfois, aussi, sous un angle féministe. Certaines penseuses jugent en effet indispensable de dénouer conjointement deux dominations qui ont été imposées ensemble. En plus de contester les inégalités qu’elles subissent à l’intérieur d’un système, elles osent critiquer ce système lui-même : elles veulent renverser un ordre symbolique et un mode de connaissance qui se sont construits explicitement contre elles.
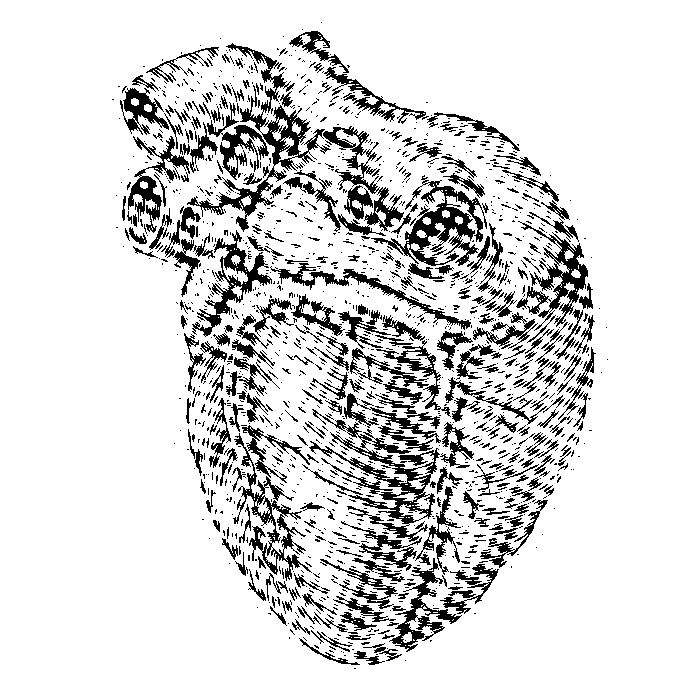
Impossible de prétendre à l’exhaustivité sur de tels sujets. Je proposerai seulement, pour chacun d’eux, un cheminement balisé par mes réflexions et mes lectures. Je m’appuierai pour cela sur les autrices qui, à mes yeux, incarnent le mieux le défi lancé aux interdits décrits ci-dessus – puisque mener une vie indépendante, vieillir, avoir la maîtrise de son corps et de son sexe reste d’une certaine manière interdit aux femmes. Sur celles, en somme, qui sont pour moi des sorcières modernes, dont la force et la perspicacité m’aiguillonnent autant que celles de Floppy Le Redoux dans mon enfance, m’aidant à conjurer les foudres du patriarcat et à slalomer entre ses injonctions. Qu’elles se définissent ou non comme féministes, elles refusent de renoncer au plein exercice de leurs capacités et de leur liberté, à l’exploration de leurs désirs et de leurs possibilités, à la pleine jouissance d’elles-mêmes. Elles s’exposent par là à une sanction sociale, laquelle peut s’exercer simplement à travers les réflexes et les condamnations que chacun a intégrés sans y réfléchir, tant la définition étroite de ce que doit être une femme est profondément ancrée. Passer en revue les interdits qu’elles subvertissent permet de mesurer à la fois l’oppression ordinaire que nous subissons et l’audace dont elles font preuve.
J’ai écrit ailleurs, en ne plaisantant qu’à moitié, que je me proposais de fonder le courant « poule mouillée » du féminisme70. Je suis une aimable bourgeoise bien élevée et cela m’embarrasse toujours de me faire remarquer. Je sors du rang uniquement quand je ne peux pas faire autrement, lorsque mes convictions et mes aspirations m’y obligent. J’écris des livres comme celui-ci pour me donner du courage. Dès lors, je mesure l’importance galvanisante des modèles identificatoires. Il y a quelques années, un magazine avait dressé le portrait de quelques femmes de tous âges qui ne teignaient pas leurs cheveux blancs ; un choix en apparence anodin, mais qui fait immédiatement resurgir le spectre de la sorcière. L’une d’elles, la designer Annabelle Adie, se souvenait du choc que lui avait fait, dans les années 1980, la découverte de Marie Seznec, jeune mannequin de Christian Lacroix à la chevelure entièrement blanche : « Quand je l’ai vue à l’occasion d’un défilé, j’ai été subjuguée. J’avais une vingtaine d’années. Déjà, je grisonnais. Elle a confirmé mes convictions : jamais de teinture71 ! » Plus récemment, la journaliste de mode Sophie Fontanel a consacré un livre à sa propre décision de ne plus se teindre les cheveux, et elle l’a intitulé Une apparition. L’apparition est à la fois celle de ce soi éclatant que la teinture dissimulait et celle de l’impressionnante femme aux cheveux blancs dont la vision, à une terrasse de café, l’a décidée à franchir le pas72. Aux États-Unis, le Mary Tyler Moore Show, qui, dans les années 1970, mettait en scène le personnage – réel – d’une journaliste célibataire et heureuse de l’être, a été une révélation pour certaines téléspectatrices. Katie Couric, devenue en 2006 la première femme à présenter seule un important journal du soir à la télévision américaine, se souvenait en 2009 : « Je voyais cette femme libre, qui gagnait sa vie toute seule, et je me disais : “Je veux ça73.” » Retraçant le cheminement qui l’a amenée à ne pas faire d’enfant, l’écrivaine Pam Houston évoque, elle, l’influence de sa professeure d’études féministes à l’université de Denison (Ohio) en 1980, Nan Nowik, qui, « grande, élégante », portait des DIU74 en guise de boucles d’oreilles75…
De retour d’un voyage à Hydra, une amie grecque me raconte qu’elle y a vu, exposé dans le petit musée local, le cœur embaumé du marin de l’île qui a le plus farouchement combattu les Turcs. « Est-ce que tu crois que si on le mangeait, on deviendrait aussi courageuse que lui ? » me demande-t-elle, songeuse. Inutile de recourir à des moyens aussi extrêmes : quand il s’agit de faire sienne la force de quelqu’un, le contact avec une image, une pensée, peut suffire à produire des effets spectaculaires. Dans cette façon qu’ont les femmes de se tendre la main, de se faire la courte échelle – de façon délibérée ou à leur insu –, on peut voir le contraire parfait de la logique du « plein la vue » qui régit les rubriques people et d’innombrables fils Instagram : non pas l’entretien d’une illusion de vie parfaite, propre uniquement à susciter l’envie et la frustration, voire la haine de soi et le désespoir, mais une invite généreuse, qui permet une identification constructive, stimulante, sans tricher avec les failles et les faiblesses. La première attitude domine dans la vaste et lucrative compétition pour le titre de celle qui incarnera le mieux les archétypes de la féminité traditionnelle – la gravure de mode, la mère et/ou la maîtresse de maison parfaite. La seconde, au contraire, nourrit la dissidence par rapport à ces modèles. Elle montre qu’il est possible d’exister et de s’épanouir en dehors d’eux et que, contrairement à ce dont veut nous persuader un discours subtilement intimidateur, la damnation ne nous attend pas au coin du bois dès que nous nous écartons du droit chemin. Il y a sans doute toujours une part d’idéalisation ou d’illusion dans la croyance que les autres « savent », détiennent un secret qui vous échappe ; mais ici, du moins, c’est une idéalisation qui donne des ailes, et non une idéalisation qui déprime et qui paralyse.
Certaines photos de l’intellectuelle américaine Susan Sontag (1933-2004) la montrent avec une grande mèche blanche au milieu de ses cheveux noirs. Cette mèche était le signe d’un albinisme partiel. Sophie Fontanel, qui en est également atteinte, raconte qu’en Bourgogne, en 1460, une femme du nom de Yolande fut brûlée comme sorcière : en lui rasant le crâne, on y avait trouvé une tache de dépigmentation liée à cet albinisme, qui était apparue comme la marque du Diable. Il y a peu, j’ai revu une de ces photos de Susan Sontag. Je me suis aperçue que je la trouvais belle, alors que, il y a vingt-cinq ans, elle me semblait avoir quelque chose d’un peu dur, dérangeant. À l’époque, même si je ne me l’étais pas formulé clairement, elle me rappelait la hideuse et terrifiante Cruella dans Les 101 Dalmatiens de Walt Disney. Le simple fait d’en avoir pris conscience a fait se volatiliser l’ombre de la sorcière maléfique qui parasitait ma perception de cette femme et de toutes celles qui lui ressemblent.
Dans son livre, Fontanel énumère les raisons pour lesquelles elle trouve beau le blanc de ses cheveux : « Blanc comme tant de choses belles et blanches, les murs peints à la chaux en Grèce, le marbre de Carrare, le sable des bains de mer, la nacre des coquillages, la craie sur le tableau, un bain au lait, le radieux d’un baiser, la pente enneigée, la tête de Cary Grant recevant un Oscar d’honneur, ma mère m’amenant à la neige, l’hiver76. » Autant d’évocations qui conjurent en douceur les associations d’idées issues d’un lourd passé misogyne. Il y a là à mes yeux une sorte de magie. Dans un documentaire qui lui était consacré, l’auteur de bande dessinée Alan Moore ( V comme Vendetta) disait : « Je crois que la magie est de l’art, et que l’art est littéralement de la magie. L’art, comme la magie, consiste à manipuler les symboles, les mots ou les images pour produire des changements dans la conscience. En fait, jeter un sort, c’est simplement dire, manipuler les mots, pour changer la conscience des gens, et c’est pourquoi je crois qu’un artiste ou un écrivain est ce qu’il y a de plus proche, dans le monde contemporain, d’un chaman77. » Aller débusquer, dans les strates d’images et de discours accumulés, ce que nous prenons pour des vérités immuables, mettre en évidence le caractère arbitraire et contingent des représentations qui nous emprisonnent à notre insu et leur en substituer d’autres, qui nous permettent d’exister pleinement et nous enveloppent d’approbation : voilà une forme de sorcellerie à laquelle je serais heureuse de m’exercer jusqu’à la fin de mes jours.
Texte pris sur Edition-zones, de Mona Chollet
https://www.editions-zones.fr/livres/sorcieres/
Merci à Julie Blanc et à l'ESAC
de Cambrai pour le workshop
Workshop du 27 au 29 octobre 2021
Justin Vankieken, A3